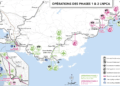Suarès l’insurgé, l’incompris, l’intransigeant. Mais surtout Suarès le Marseillais, dont la ville natale n’aura jamais daigné lui décerner le succès qu’il méritait. Entre le poète et sa ville, c’est un amour manqué, une succession d’incompréhensions et de brouilles qui écrivent aussi la légende de cet artiste maudit et trop injustement méconnu. Et que se dit-on, justement, lorsqu’à mesure que passent les années, la gloire qui nous est promise nous échappe ? Sans doute qu’elle viendra après notre mort.

C’est en tout cas ce qu’écrit André Suarès en 1911, dans un texte aux allures étranges de prophétie, qui ne se réalisera pas tout à fait : « On me lira en l’an 2000, on m’aimera, on se pressera autour de moi, qui ne serai plus là ; ou plutôt si, je me trompe totalement : j’y serai et ma vie présente, mon horrible vie aura été la rançon de cette autre vie-là, étant ma folie que de n’avoir jamais vécu que dans la vie future. »
Tandis que les poètes maudits meurent dans l’éclat de leur jeunesse, Suarès, lui, s’est contenté de s’éteindre à l’âge de 80 ans, c’est-à-dire bien trop tard pour que cet âge puisse alimenter son hagiographie d’artiste auquel le succès échappe. Il faut dire que Suarès fit tout pour s’en éloigner, du succès, ou du moins de celui qui s’attrape facilement, à travers des compromis qu’il s’est toujours empressé de refuser. Car comme le glissait malicieusement Louis Jouvet : « Le succès n’explique rien mais il justifie tout ».
Philippe Caubère remonte sur scène pour Marsiho
Aujourd’hui, il existe bien un homme animé du désir de faire revivre l’esprit du poète : le comédien et metteur en scène Philippe Caubère, qui sera sur les planches du théâtre Sémaphore à Port-de-Bouc, vendredi 26 septembre 2014 à 20 h 30 pour son spectacle Marsiho, le nom provençal de Marseille. Depuis plus de dix ans, c’est presque une seconde nature, une mission, un destin. Et même peut-être une psychanalyse, comme il le rappelait avant son interprétation au Off d’Avignon, en juillet 2012.
Regardez un extrait du spectacle Marsiho de Philippe Caubère :
Défendre celui qu’on a pourfendu. N’avoir aucune indulgence mais retrouver la passion qui animait Suarès, le lyrisme, de celui qui, pour Caubère, a écrit avec Marsiho (1929) le « plus beau livre sur Marseille ». Avant lui, Robert Parienté tressait déjà les louanges de Suarès : une plume au service de l’intégrité. Un refus des conventions et des mondanités, une recherche constante de l’émotion esthétique et de la beauté (« Je suis un messager de la beauté, un rêveur d’émotion », écrivait Suarès). Et une intransigeance qui lui fit perdre plusieurs amitiés. Voici peut être la recette pour être, comme l’écrivait Robert Parienté dans sa biographie du poète « victime de la conspiration du silence et de l’un des plus incroyables dénis de justice de la littérature » (André Suarès, l’insurgé, chez Robert Laffont, 1999).
Marseille lui a toujours refusé le succès
André Suarès est né à Marseille, en 1868, dans une famille israélite d’origine italienne par son père et provençale par sa mère. Israélite : c’est ainsi qu’on désignait les juifs, à un époque où la République assimilait les communautés dans un moule national. Une République qui fut l’une des premières à octroyer des droits (et des devoirs) citoyens à une communauté qui en était largement exclue. Déjà, dans sa jeunesse, Suarès éblouit : lycéen, il obtient le premier prix du Concours général de français, une épreuve qui à l’époque vaut tous les brevets du monde. Ensuite reçu à l’École Normale de la Rue d’Ulm, il y croise Romain Rolland, mais échoue à l’agrégation d’histoire. « Parfois considéré, dans les années vingt, comme l’égal de Gide, Valéry et Claudel (avec qui il anima la Nouvelle Revue Française, ndlr), c’était un visionnaire que respectait Jean Paulhan, un éblouissant styliste qu’admirait Alain-Fournier, un fascinant portraitiste qu’affectionnait André Malraux, un penseur profond que reconnaissait Henri Bergson, un critique d’art aux vues futuristes que côtoyaient Georges Rouault et Antoine Bourdelle, un poète inspiré qui subjuguait Stefan Zweig », écrit Parienté dans sa biographie.
On ne comprend pas, dès lors, qu’avec de telles références, l’auteur ait si peu franchi les frontières de la notoriété. C’est peut être que ce « grand génie » au « destin maudit », comme l’affirme l’acteur Philippe Caubère, n’est d’abord jamais entré dans le cœur de Marseille, là où tout a commencé. « Marsiho, c’est une peinture extraordinaire, incroyablement moderne, du Marseille des années trente. Il donne de la ville une image très différente de celle qui coure ordinairement, et surtout actuellement », s’enflammait Philippe Caubère, qui a découvert dans l’agitation de cette prose le portrait fidèle d’une ville qu’il aime par-dessus tout.

« Cette œuvre est une véritable peinture de la ville, elle porte quelque chose de l’identité marseillaise. Un Marseillais d’aujourd’hui ne peut rester de marbre face à une telle pérennité. Néanmoins, beaucoup de Marseillais d’appartenance disent également qu’ils y reconnaissent des choses qu’ils n’osent pas ou ne savent pas exprimer. Marsiho possède des vertus de dévoilement incontestables. Ce qui est assez exceptionnel, c’est que Suarès aime vraiment la ville, dans le sens où il ne cache pas ce qui lui déplaît en elle, ses défauts », continue Caubère, interrogé par Marsactu. « Marsiho est une peinture incroyablement moderne du Marseille des années 1930. Des images vraies, bien plus vraies que celles que nous offrirait n’importe quel film ou documentaire, ces images que seuls le roman, le théâtre ou les rêves savent fabriquer dans notre imagination », juge Caubère, dans un texte de présentation de son spectacle. Effectivement, dans ce texte comme dans d’autres, Suarès aime critiquer Marseille. Une attitude typiquement… marseillaise ! « De toutes les villes illustres, Marseille la plus calomniée. Et d’abord, Marseille calomnie Marseille. Chaque fois qu’elle tâche à n’être plus elle-même, elle grimace, elle se gâte au miroir de sa lie », reconnait le poète, dans Marsiho.
Marseille sent. Marseille fait du bruit. Marseille s’épuise à s’agiter et, surtout, ne se laisse pas faire. C’est ainsi que le poète décrit la ville dans ce fameux texte qui ouvre les années 1930 : « Marseille n’a jamais subi un maître. À travers les siècles, elle n’a jamais eu de dictateur. […] J’offre pour rien un conseil aux innombrables bâtards de la Louve : qu’ils rentrent leur langue derrière leurs dents, et leurs dents derrière les tranchées de leurs nouilles. Qu’ils prennent garde, en dépit de l’oracle des Martigues, à ne pas trop racler, de leur archet en forme de faisceau, les nerfs de Marseille. Les vêpres marseillaises seraient infiniment vengeresses des siciliennes ». [pullquote]« C’est la mer, ce que j’aime le plus, le ciel liquide où l’on embarque, où l’on navigue : la planche est retirée, on est à bord comme l’on ressuscite, et déjà dans une autre vie […] C’est la mer où j’ai vécu ma plus belle part, la mer qui m’est commune comme si j’en étais sorti». (André Suarès, Bouclier du Zodiaque, Le Cherche-Midi, 1994).[/pullquote]
« Fixé à Paris à partir de 1897, André Suarès demeure un homme de la Méditerranée », écrit Robert Parienté, dans un texte intitulé André Suarès, entre mer et terre, publié dans la Pensée de Midi en 2000 (Actes Sud). Les tragédies grecques sont sa source, tout comme leurs codes esthétiques et leur quête d’une connaissance absolue, qu’il partage avec les savants de l’Antiquité.
Suarès, un homme de la Provence
Suarès a voyagé, mais trop peu à son goût, notamment en Provence. Et l’on aperçoit alors toute l’ambiguïté de sa relation avec Marseille, qui se distingue des autres destinations. Dans son fameux texte, le Voyage du Condottiere, en trois volets (1902 à 1932), il écrit : « Celui qui naît et grandit à Marseille n’a pas besoin de partir : il est déjà parti. Comme ils rencontrent tous les visages et tous les peuples de la terre, entre les allées de Meilhan et les ports, la plupart des enfants ne rêvent pas de voir le monde. Un petit nombre d’autres brûle, au contraire, de tout quitter et de mettre cap au large. Plus fort que le désir de la mer, la nostalgie d’ailleurs. Où ? Ailleurs. À quelle fin ? Ailleurs. Pour quoi ? Ailleurs est le nom du pays inconnu, le plus beau des pays. Ailleurs, le pays où l’on n’est pas et où l’on pourrait être ; celui où nul n’a été, jusqu’à ce qu’on y soit ». Etrange sentiment que cet exil intérieur, cette quête de sens, de joies, que le poète ne parvient pas à trouver. Bizarrement, il traîne son spleen comme son illustre prédécesseur Charles Baudelaire, alors que cette mélancolie semblait cantonnée à des Parisiens dont la « pensée solaire » de la Méditerranée est étrangère.

Dans ses voyages en Provence, André Suarès est passé dans certains villages de la future métropole d’Aix-Marseille Provence. Auriol, par exemple, qu’il décrit à merveille dans ses Croquis de Provence (André Suarès, Idées et visions, Bouquins Robert Laffont) : « La montagne pèse sur Auriol. Elle met au bourg un capuchon d’ombre. Mais la lumière est plane sur le vaste plateau venteux, au-delà. Il y a, en ce lieu clair, de la tristesse sans mystère ». Et de s’attarder sur les cigales qui font « leur concert de cymbales », l’été, tandis que les filles « rient amoureusement » sous les platanes. Le retour à Marseille est, toujours, une souffrance : « cette route au soleil est un enfer », tranche-t-il, plus loin.
Marseille n’est qu’un point de départ
Pour Suarès, Marseille est un point de départ. Ce fut celui de son adolescence où il s’ennuya à mourir. C’est pour lui le tremplin vers une autre vie, un point de mouvement, rien de plus : « En Provence, je suis en rade. Il n’est point de port qui donne le départ à l’égal de Marseille (…) La mer à Marseille ne connaît pas le flux ni le reflux, ou si peu que rien […] Le fond grec et provençal de ce peuple repousse le chaos ; une gaîté puissante est le second mistral qui souffle du Rhône sur les collines sœurs de l’Ionie […] Marseille est universelle » (André Suarès, Marsiho, Trémois, 1930, bois de Louis Jou ; Grasset, 1933 ; Jeanne Laffitte, 1980). Une fois quitté la ville et installé à Paris, il revient chaque année en Provence, « en prenant soin d’éviter Marseille », raconte Robert Parienté. Avignon, Arles, Tarascon, Beaucaire, Montmajour, Saint-Rémy, Les Baux, Toulon : il rédige alors des textes pour chacun de ses pèlerinages, car pour son biographe : « La Provence est le miroir de l’âme de Suarès ».
Finalement, pourquoi Suarès n’a-t-il pas le succès et l’estime de sa ville d’origine, Marseille ? Peut être parce qu’il se place résolument du côté des écrivains français, et non pas de ceux de la région, et qu’il s’identifie plus à la France qu’à Marseille. Peut être aussi parce qu’il a quitté cette dernière pour rejoindre Paris, où il n’a d’ailleurs pas obtenu de fastueux succès : « C’est le mystère Suarès. Lui-même en avait bien conscience, déjà à l’époque, puisqu’il a écrit sur la gloire qui lui était refusée à Marseille, mais aussi à Paris. Il fait partie des grands génies méconnus, à la manière de Fernando Pesoa, longtemps ignoré par les Portugais avant qu’ils ne reconnaissent en lui l’un des plus grands poètes du monde… En tout cas les poètes sont méprisés en France, ce n’est pas nouveau. Suarès n’était ni vraiment un romancier ni un philosophe, et, en plus, il était de droite », raconte Philippe Caubère.
À l’automne 1929, Suarès doit quitter son domicile parisien. Il se réfugie à Collioure et ensuite chez amis près de Toulon. C’est à ce moment là qu’il achève Marsiho, – qu’il a commencé quatre ans plus tôt -, achevé hors de Marseille, donc, mais tout proche, à portée de mots. Est-ce cette dernière salve qui l’incite à retourner à Marseille, une dernière fois ? Il ne l’avait pas revue depuis 15 ans, et « reconnaît que le plus beau luxe est la vie. » (Robert Parienté). La défaite l’emporte vers le retour mais, contrairement aux apparences, ce retour n’est pas un échec, c’est un recommencement. « Marsiho, poème d’amour en prose, où il peint sans concession les splendeurs et les misères de sa ville, est le cri du cœur d’un homme qui a gardé son âme d’enfant », conclut Robert Parienté.
Infos pratiques :
Marsiho, vendredi 26 septembre à 20 h 30 au Théâtre Sémaphore à Port-de-Bouc – rue de Turenne, 13110
Adaptation et mise en scène : Philippe Caubère
Tout public : 12 euros / Adhérents, chômeurs, étudiants : 8 euros / RSA et moins de 18 ans : 4 euros
Tél : 04.42.06.39.09
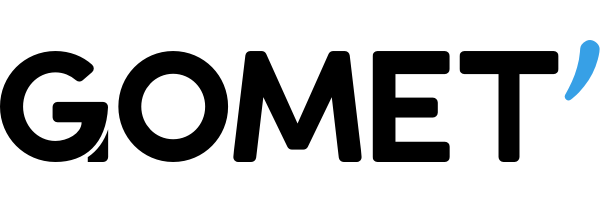




![[Agenda] Aix-Marseille Provence : que faire ce week-end des 25, 26 et 27 avril ?](https://gomet.net/wp-content/uploads/2025/04/rubrique-agenda-we-1-1140x570-1-120x86.png)