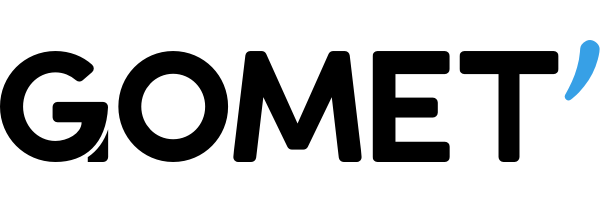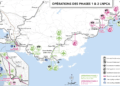Le développement technologique territorial date d’un peu plus de 50 ans. Il a beaucoup évolué : parcs technologiques, technopôles, pôles de compétitivité, clusters, … Toutes ces structures sont aujourd’hui confrontées à des changements d’échelle et à des besoins croissants de la population. Entre mondialisation et proximité sociale, les nouveaux défis sont nombreux. Jacques Boulesteix (*), scientifique reconnu, astrophysicien, créateur du pôle Optitec, est aussi engagé dans la sphère politique. Il a notamment milité au sein des Groupes d’actions métropolitains. Il nous livre aujourd’hui une série de chroniques sur l’innovation régionale et ses nouveaux enjeux.
1970-2000 : le fait technopolitain
La première initiative de mutation technologique de l’économie française s’est matérialisée par la naissance des technopôles, conçus comme des espaces protégés, consacrés aux hautes technologies, basés sur une stratégie territoriale simple et efficace : (re)localiser les entreprises technologiques sur un territoire susceptible d’accélérer leur développement en proximité d’écoles d’ingénieurs et de laboratoires de recherches. Sophia Antipolis constitua, dès 1969, un précurseur largement financé par l’Etat (Datar), suivi de Grenoble en 1971. Ils ne faisaient que s’inscrire dans le sillage de la Route 128 (le “demi-cercle magique” de Boston), apparu à la fin des années 50 en proximité de l’Université de Harvard et du MIT, et de la Silicon Valley en Californie dans les années 60 autour des entreprises de semi-conducteurs et de l’Université de Stanford.

Les technopôles sont donc avant tout, à cette époque, des lieux structurés pour favoriser les relations université-recherche-entreprises, avec l’idée simple de « transformer l’intelligence en richesse ». Dans les Bouches-du-Rhône, trois technopôles virent ainsi le jour.
Premier en date, le technopôle de Luminy fut structuré en 1985 autour des bio-techs sur un site universitaire développé dans les années 1970 autour des mathématiques, de la physique, de l’architecture et du sport. Il s’étend sur une centaine d’hectares.
Le technopôle de Château-Gombert date, lui, du début des années 1990 et correspondait plutôt à la thématique des sciences de l’ingénieur. Il fit l’objet d’une action à la fois financée par l’Etat avec la création de l’Institut Méditerranéen de Technologie (IMT) et par la ville de Marseille avec une opération foncière touchant 180 ha. L’implication de l’Etat, avec le déménagement d’écoles d’ingénieurs et celle de la Chambre de Commerce, avec la création de la Maison du Développement Industriel (MDI), furent déterminantes. Le scientifique et ministre Hubert Curien fut d’ailleurs président du Groupement d’Intérêt Public créé à cet effet.
Le technopôle de l’Arbois démarre, lui, en 1995, avec l’installation du Centre de recherche et d’enseignement de géosciences de l’environnement (CeReGE) dans les locaux rénovés de l’ancien sanatorium. Il se développe vraiment dans les années 2000, sur 75 ha, autour de la thématique de l’environnement.

De 1970 aux années 2000, la structuration du monde de l’innovation en France est donc marquée par la création de divers “technopôles” (au masculin), de “technopoles” (au féminin), de “parcs technologiques”, de “parcs scientifiques”, de “zones d’innovations”, de “vallées scientifiques”, de “polygones technologiques”, qui, quel que soit le vocable, se réfèrent tous au même concept : un espace spécifique protégé à vocation scientifique et technologique. Il y en a une cinquantaine en France.
Les technopôles : un bilan positif, mais contrasté
Le bilan de ces 40 années d’existence est contrasté. Bâtis sur le modèle américain de la Silicon Valley, ils sont loin d’avoir eu son dynamisme. Selon le réseau Retis et une enquête du journal Les Echos en 2022, les 43 technopôles référencés regroupent 14 000 entreprises et 180 000 salariés. C’est évidemment bien loin des 504 000 emplois du secteur de l’innovation localisés dans la Silicon Valley (auxquels il faudrait rajouter 571 000 emplois dans l’innovation en Californie du Sud). En fait, si les technopôles français ont largement contribué à développer les synergies entre les entreprises innovantes et la recherche publique, ils n’ont jamais vraiment réussi à concentrer les outils et les moyens de leur développement.
L’une des critiques est que la concentration d’activités technologiques les isole de fait du reste de la vie économique. Le croisement vertueux de la connaissance y reste limité. Les technopôles peinent à rayonner sur l’ensemble du tissu économique local. Les initiatives communes des différents acteurs publics et privés se heurtent rapidement aux clôtures-même du technopôle : il y a ceux qui sont à l’intérieur et ceux qui sont à l’extérieur. Le développement du concept, théoriquement plus ouvert, de technopôles urbains (comme Château-Gombert) n’a pas pleinement répondu à cette difficulté.

Le second problème est que les technopôles n’ont pas réussi (à quelques exceptions près) à attirer un financement suffisant pour le développement de leurs entreprises. D’ailleurs, même aujourd’hui, si en France comme en Europe, la valeur des investissements en capital-risque a triplé en 10 ans, le fossé continue de se creuser avec les Etats-Unis où cet effort est plus du triple de celui de toute l’Europe et se concentre particulièrement sur les zones technologiques peu nombreuses, hébergées sur une dizaine d’Etats seulement. De plus, la part du capital-risque consacrée à l’innovation scientifique et technologique est inférieure à 50% en Europe et supérieure à 85% aux USA. Et la seule Silicon Valley concentre 20 à 25% de tout l’investissement capital-risque américain en matière d’innovation…
Les politiques locales sont aussi parfois contestées : concernant les technopôles français, si les opérations foncières à maîtrise publique ont été déterminantes, elles ont été bien souvent, pour des raisons de rentabilité à court terme, alimentées par des opportunités de relocalisations d’entreprises existantes au détriment de l’aide aux start-up. Même si les lieux d’hébergement dédiés (espaces de coworking, pépinières, incubateurs, accélérateurs) se multiplient, la fragmentation existe et elle n’est pas toujours favorable à l’innovation.
Les technopôles ne pouvaient donc répondre seuls au défi de l’innovation. D’ailleurs, les acteurs-mêmes l’avaient bien compris. En Provence, il y aurait eu place à un technopoles marin et portuaire ou à un autre dans le domaine de l’aéronautique. Ces deux secteurs étaient développés, dynamiques, localisés et avaient besoin d’innovation. Mais dès les années 2000, le vent avait tourné. Le développement de réseaux, de nouveaux pôles, non localisés semblait plus prometteur.
Prochain volet (dimanche prochain): Les années 2000 : les pôles de compétitivité
(*) Jacques Boulesteix est astrophysicien, ancien directeur de recherches au CNRS. Elu à la mairie de Marseille de 1989 à 1995, il est alors chargé du développement des technopoles et des universités. Président-fondateur de POPsud en 2000 puis d’Optitec en 2006, il crée également le Comité national d’optique et photonique regroupant les pôles régionaux en optique ainsi que les industriels de la filière. A la fin des années 2000, administrateur de la plateforme européenne Photonics 21, il crée le réseau Optique méditerranéen, ainsi que l’European network of optical clusters. Il dirigea de 2010 à 2018 le fond régional d’investissement Paca Investissement.