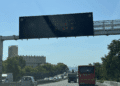A quand le mot d’excuse ?
Entendu dans la bouche d’un leader CGT cette explication : « Il y a baisse de la mobilisation en raison des vacances… » Un mot d’excuse qui fait écho à une phrase entendue sur la Canebière, sur les quais de la gare Saint-Charles, ou encore, dans quelques amphis occupés : « On ne lâchera rien ! » Sauf pendant les congés, qui sont sacrés depuis qu’ils sont payés. On imagine la tête des anciens qui ont, en leur temps, occupé leur entreprise. A l’époque, pas un d’entre eux n’aurait imaginé brandir des calicots, sur lesquels ils auraient gravé « usine occupée, cinq jours sur sept » ou « occupation interrompue en raison des congés de Pâques ». La poignée de trotskystes ou de maoïstes, qui déambulent encore dans les défilés, doivent voir rouge, lorsqu’ils regardent cette classe ouvrière qu’ils ont imaginé un peu vite « fer de lance » d’une révolution, qui tarde à venir. Lénine disait « là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Oui, mais quand la volonté est faible ? Cela nous rappelle une anecdote mettant en scène le Premier ministre britannique pendant que Londres était sauvagement bombardée par la Luftwaffe. Un de ses collaborateurs lui demande : « Sir, pourrais-je prendre le prochain week-end ? », « Pourquoi, lui rétorqua Churchill, vous n’aimez pas cette guerre ? » Les grévistes aiment-ils suffisamment leur grève ?
On s’inquiétait, mais ils existent
Nous l’avons déjà dit ici. La République en marche ne fonctionne pas à l’ancienne. Sa relation avec ses militants est digitale. De quoi surprendre, notamment à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, où on aime le contact qu’il soit rude ou amical et où la tradition orale compte. Au PS, chez les Républicains, au PC, chez les Insoumis, au Front national et tant d’autres encore, rien de tel pour porter des idées que de claquer la bise, tenir par la taille ou l’épaule, et lever le coude au nom d’une amitié indéfectible, quoique souvent réversible. Pas chez les supporters de Macron. Si le patron va au contact, embrasse, malaxe … c’est un peuple souterrain qui s’affaire avec ici et là quelques réunions thématiques, aussi conviviales qu’un congrès de Mormons. Du coup, on a presqu’oublié que la moitié des députés du 13, soit huit sur seize, sont labellisés LREM. Il aura fallu la loi sur l’immigration pour détecter comme un frémissement, dans les rangs très serrés de cette jeune formation ultra-majoritaire. Quelques noms remontent même à la surface pour dire une nuance ou un commencement d’avis personnel. Dans la série Versailles qui vient de reprendre sur Canal+ pour une ultime saison, on constate que le Roi soleil n’arrive pas à reléguer dans l’ombre tous ses sujets. Depuis un an, notre monarque républicain y est parvenu, mais les sondages attestent que ce n’est pas pour sa gloire.
La bataille du terrain
La municipalité envisage de piétonniser la Canebière dans deux ans. On s’en réjouit. Comme on doit saluer le renouveau de la rue Paradis qui permet d’accéder à l’épine dorsale de la ville. D’autres, dans le Sud, ont compris l’importance qu’il y avait à organiser un point central, vers lequel confluait tous ceux qui font la ville vivante, des actifs aux visiteurs. Il y va de la rencontre nécessaire sans laquelle une ville est morte. Pour y parvenir, les recettes et les principes sont les mêmes. Chasser les voitures, aménager l’espace et, cerise sur ce gâteau urbain, assurer la propreté permanente. Il en va ainsi à Bordeaux, Toulouse, Montpellier et plus proche de nous à Aix. Dans cette dernière, les élus, depuis plusieurs décennies, ont pris un soin particulier à l’artère sur laquelle est fondée la réputation de la ville, le cours Mirabeau. Chaque matin, les karchers lustrent sa pierre de Chine, jusqu’à parfumer l’eau qui l’éclabousse pour effacer les stigmates canins. On en est encore loin à Marseille même si une fois par mois les dimanches piétonniers vont en ce sens. La rue Paradis justement pourrait servir de laboratoire et nettoyer ses trottoirs le matin ne nuirait pas à son éclat. Pourquoi ne pas doter les commerces du tuyau qui permettrait de voir midi briller à sa porte… une déduction de l’eau consommée serait un encouragement ? Il n’est pas interdit de croire que l’imagination sera un jour au pouvoir.
Embarquement immédiat
Les Marseillais tournent le dos à la mer. C’est vrai, mais faux « en même temps », comme on le dit désormais. Certes, il y a toujours pour le Marseillais une certaine crainte à affronter cette Méditerranée que l’on dit féconde, mais qui charrie tant de malheurs et engloutit autant de vies. Marcel Pagnol le faisait dire à sa façon inimitable à ses personnages. Lorsque Marius avoue à son père qu’il va s’embarquer pour aller dresser, au très grand large, des cartes marines et sonder le fonds des mers, César lui répond : « Laisse mesurer les autres ! ». Et puis il y a eu cet épisode du Grand Saint Antoine, navire qui importa la peste en 1720. Une telle catastrophe a marqué durablement le peuple phocéen, d’autant qu’était encore inscrite dans la mémoire collective la mise à sac de la ville par Alphonse V d’Aragon, en 1423. L’Ibère a, du reste, emporté avec lui la chaîne qui commandait l’entrée du Vieux-Port, et qui trône toujours insolemment sur un des murs de la cathédrale de Valencia. Il y eut des jours meilleurs et des navires amis. Quelques champions transatlantiques bien sûr, pour venir tutoyer les records entre la France et l’Afrique. Le Phocéa de Bernard Tapie pour faire chavirer les foules avec une certaine coupe d’Europe. Le Belem, valeur sûre de la marine à voile. Et puis et enfin l’Hermione pour raconter Lafayette et la liberté conquise outre-Atlantique. La réplique de la frégate qui fila vers l’Amérique à la fin du XVIIIe siècle a conquis le cœur des Marseillais et les a sans doute un peu réconciliés avec la mer.
Allez, mangeons du Lyon
Les plus anciens s’en souviennent, les plus jeunes en rêvent. Quelques-uns maugréeront en regrettant que l’Olympique de Marseille ne court pas après la coupe aux grandes oreilles, comme en 1993, mais vise sa petite sœur, moins prestigieuse forcément. A regarder et à entendre les Marseillais et tant d’autres venus en rangs serrés au vélodrome, cette nuance importe peu. Qu’importe le flacon, c’est l’ivresse des grands soirs que recherchent ceux qui aiment le maillot bleu et blanc. Celle à partir de laquelle on peut bâtir des légendes, enjoliver la réalité et faire naître les héros. Le peuple de l’OM est une fois de plus parti à l’assaut de la Bastille européenne. Le dîner de gala aura lieu à Lyon, si les hommes de Rudy Garcia font un festival à Salzbourg. La ville autrichienne est plus connue pour l’hommage qu’elle rend chaque été à Mozart. L’OM souhaite y interpréter un requiem, pour ceux qu’elle a battus ici 2 à 0. La fugue finale ce sera à Lyon pour Arsenal ou l’Atlético de Madrid. Le pied gauche de Thauvin face au pied droit de Griezmann. Olé !
Les chercheurs cherchent
« Des chercheurs qui cherchent, on en trouve ; des chercheurs qui trouvent, on en cherche ». On a longtemps attribué cette vacherie au général De Gaulle, mais quelques-uns soupçonnent un journal satirique paraissant le mercredi de le lui avoir glissé dans la bouche, sans autre forme de vérification. Ainsi va la réputation de ceux qui sévissent dans les laboratoires ou devant leurs ordinateurs. Cela ne les empêche pas d’avancer et Aix-Marseille récolte régulièrement sa part de lauriers, lorsque nos professeurs Tournesol se distinguent. L’université d’Aix-Marseille a ainsi été citée à deux reprises ces derniers jours dans des domaines qui ne sont pas toujours placés sous les projecteurs. Elle travaille ainsi à Rochechouart (Haute-Vienne) sur l’impact d’une météorite, il y a deux cents millions d’année. Les scientifiques impliqués dans les recherches expliquent que cet accident pourrait notamment nous éclairer sur les origines de la terre. Et puis c’est un imitateur inimitable qui a salué le travail d’une autre équipe d’Aix-Marseille. Laurent Gerra a confié sur France 2 son admiration pour les scientifiques du laboratoire Langage et parole d’Aix, qui ont pu mesurer l’exactitude de certaines des voix qu’il imitait notamment celle de Jacques Chirac. Qui a dit qu’on ne parlait que de la médecine pour cette université ?