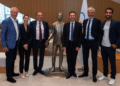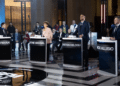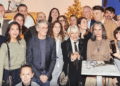Un dégât des eaux survient rarement au bon moment : fuite d’un tuyau, débordement d’un appareil, infiltration sous la toiture… Autant de situations qui peuvent vite causer des dégâts importants.
La garantie dégâts des eaux, prévue dans la plupart des contrats d’assurance habitation, offre une protection essentielle pour en atténuer les conséquences et réparer les dommages. Avant de faire une déclaration, il reste essentiel de bien comprendre ce que cette garantie prend en charge… et ce qu’elle exclut.
Que couvre la garantie dégâts des eaux ?
Une fuite, une infiltration ou un débordement peut rapidement endommager un logement. La garantie dégâts des eaux couvre alors les conséquences de ces incidents, selon les conditions prévues au contrat. Elle s’applique notamment dans les situations suivantes :
- fuite, rupture ou débordement d’une canalisation non enterrée ;
- débordement d’un appareil électroménager, d’un radiateur ou d’un sanitaire ;
- infiltration d’eau par la toiture, les murs ou les gouttières ;
- engorgement ou débordement des conduits d’évacuation.
Selon l’ampleur du sinistre, les conséquences peuvent être très différentes. La plupart des contrats d’assurance habitation prévoient une prise en charge des dommages affectant :
- la structure du logement (plafonds, murs, planchers) ;
- les embellissements tels que la peinture ou les revêtements ;
- le mobilier et les appareils électroménagers ;
- et parfois la privation de jouissance, lorsque le logement devient inhabitable pendant les réparations.
Quelles sont les limites et exclusions de la garantie ?
Fuite, infiltration, canalisation qui cède : la garantie dégâts des eaux couvre les conséquences de ces incidents sur votre logement. Elle protège aussi bien la structure du bien que le mobilier, dès lors qu’il s’agit d’un sinistre accidentel et non d’un défaut d’entretien. Sont généralement exclus de la garantie :
- les infiltrations dues à un manque d’entretien (joints usés, toiture abîmée, fenêtre mal fermée) ;
- les fuites de canalisations souterraines ;
- les dommages causés par la condensation, l’humidité ou la porosité des murs ;
- les dégâts liés à des événements naturels comme une inondation, la montée des eaux ou le gel d’une chaudière, car ces sinistres relèvent alors de la garantie catastrophes naturelles ;
- la réparation de l’appareil ou de la canalisation à l’origine du sinistre, qui reste à la charge du propriétaire sauf mention contraire du contrat.
Comment fonctionne l’indemnisation en cas de dégât des eaux ?
En cas de dégât des eaux, prévenez rapidement votre assureur. Vous disposez de cinq jours ouvrés à partir du moment où vous constatez le sinistre. La déclaration peut se faire très simplement : en ligne, par téléphone ou par courrier, selon les options offertes par votre contrat.
Elle doit mentionner :
- vos coordonnées et votre numéro de contrat ;
- la date et les circonstances du sinistre ;
- une description des dommages constatés ;
- les justificatifs utiles : photos, factures, constat amiable s’il y a plusieurs logements concernés.
Dans la plupart des cas, un expert est mandaté pour évaluer l’origine du dégât et estimer le montant des réparations. L’indemnisation s’appuie ensuite sur la valeur des biens assurés :
- en valeur d’usage, lorsque la vétusté est déduite ;
- ou en valeur à neuf, si cette option figure dans le contrat.
Le versement de l’indemnisation intervient après validation du rapport d’expertise, dans un délai qui peut varier selon les compagnies d’assurance.
En dessous de 5 000 € HT, la convention IRSI permet d’organiser la répartition des frais entre les assureurs, afin de faciliter le règlement du sinistre.
Propriétaire ou locataire : qui déclare et qui est responsable ?
En cas de dégât des eaux, la responsabilité dépend avant tout de l’origine du sinistre et du statut de l’occupant.
Si vous êtes locataire, la loi ALUR du 24 mars 2014 vous oblige à souscrire une assurance habitation. Elle inclut la garantie « risques locatifs », qui protège votre logement en cas de dégât des eaux, d’incendie ou d’explosion. Et si le sinistre atteint l’appartement voisin, c’est votre responsabilité civile qui couvre les réparations.
Si vous êtes propriétaire occupant, rien ne vous oblige à souscrire une garantie dégâts des eaux. Mais elle reste vivement conseillée : en cas de fuite ou d’infiltration, tous les frais de réparation resteraient à votre charge sans assurance habitation.
Si vous êtes propriétaire d’un logement que vous n’occupez pas, la loi vous impose d’avoir une assurance habitation lorsqu’il se trouve en copropriété. Elle permet de couvrir les dommages qui pourraient toucher les parties communes ou d’autres appartements.
En pratique, si la fuite ou l’infiltration provient du logement de l’assuré, c’est sa propre compagnie d’assurance qui prend en charge les réparations selon les conditions prévues au contrat. Si la cause du sinistre est extérieure, par exemple une fuite venant d’un autre appartement, l’indemnisation relève de l’assureur du responsable. Enfin, lorsque les dommages concernent les parties communes, c’est l’assurance du syndic de copropriété qui intervient.
Comment prévenir les dégâts des eaux ?
Mieux vaut prévenir que réparer : en matière de dégâts des eaux, cette maxime se vérifie à chaque sinistre. Un entretien régulier du logement reste la meilleure façon d’éviter les fuites et les infiltrations. Vérifiez périodiquement l’état des joints, de la robinetterie et des canalisations, sans négliger la toiture, les gouttières et les fenêtres après de fortes pluies ou des rafales de vent.
Avant de quitter votre logement pour plusieurs jours, pensez à fermer l’arrivée d’eau principale. Ce simple geste limite considérablement le risque de fuite accidentelle en votre absence. Dans les régions où les hivers sont rigoureux, isolez les canalisations pour éviter qu’elles ne gèlent et se fissurent, car les réparations peuvent vite devenir importantes.
Enfin, surveillez votre consommation d’eau : une variation inhabituelle peut révéler une fuite invisible. En cas de doute sur l’état de vos installations ou sur un matériel vieillissant, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel. Ce type de contrôle préventif coûte souvent bien moins cher qu’une réparation après sinistre.