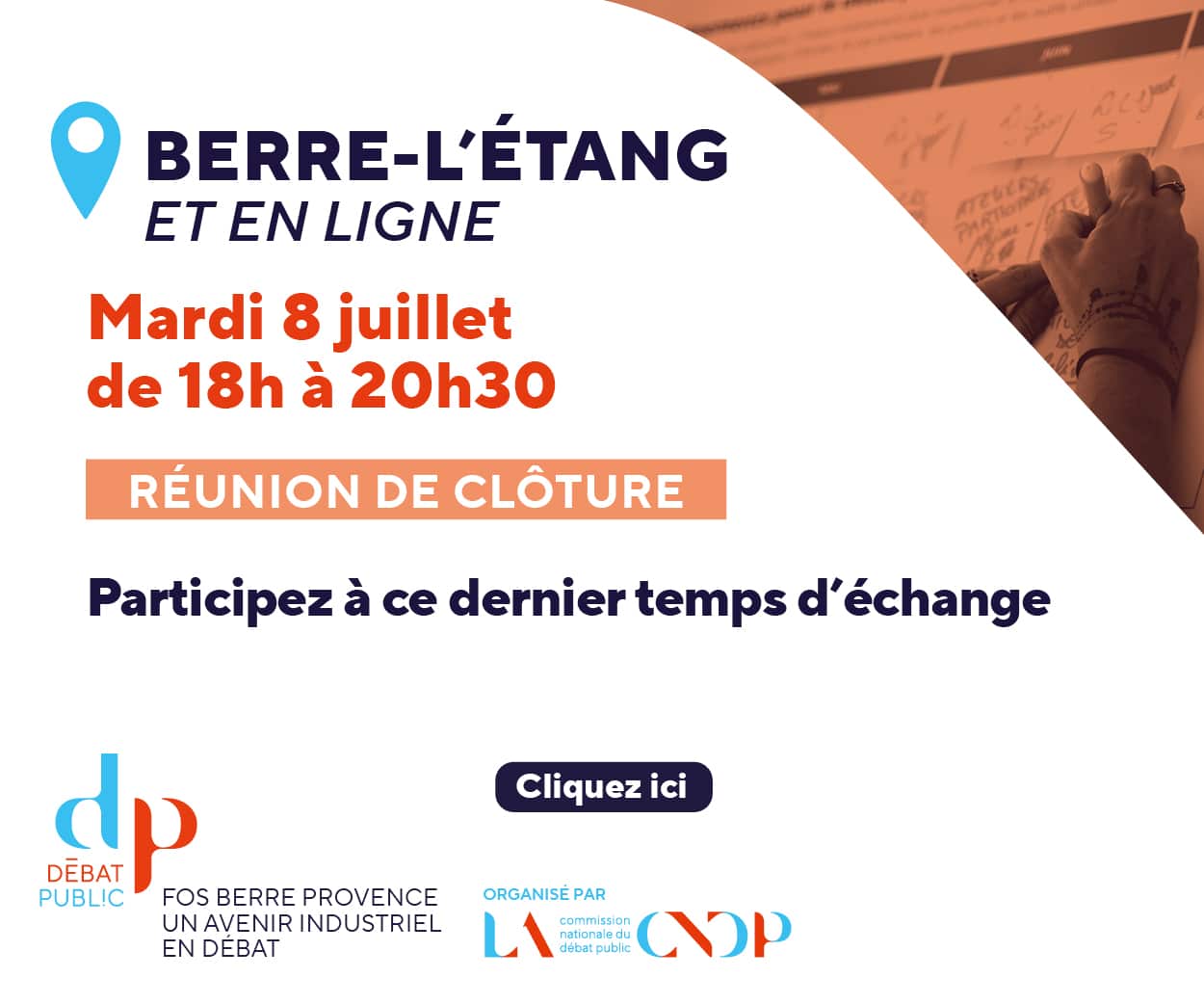« Comptez les grues » dit-on dans le bâtiment pour apprécier la conjoncture. Les grues sont pléthore et la reprise est évidente : nos villes font tourner les bétonnières. Mais pour quoi faire ? Pendant la pandémie, il était évident pour tous ce que « rien ne serait comme avant ». Mais qu’est-ce qui a changé dans la construction ? C’est le sens de ce hors-série que d’interroger ce qui se dessine sur notre territoire régional, pour penser ce qui se construit et ce qui se vivra demain.
En fait les professionnels disent à l’unisson, que la pandémie a accéléré des tendances déjà à l’œuvre, à bas bruit, depuis une dizaine d’années. Le dernier Mipim a montré que la préoccupation de l’écoconstruction s’impose à tous et que les promoteurs font assaut de démonstrations sur leur bilan carbone, leur isolation, leur aération, leurs coûts de chauffage et de refroidissement. Julie Rampal nous rend compte des tendances du marché international cannois. Et Jean-Pierre Largillet nous relate comment Sophia-Antipolis est en train de reconstruire Sophia-Antipolis sans s’étendre au détriment de la garrigue.
L’écoconstruction devient la norme
Dans ce que chacun revendique sous le vocable d’écoconstruction, il y a, d’une part ce qui relève de la loi, de la règle, de la norme, et d’autre part le supplément d’écologie, de verdissement que le promoteur ajoute au projet. Rémi Liogier fait le point avec le CSTB sur les définitions de base et la prospective des normes de nos habitats et de nos bureaux.
Le télétravail a été imposé de façon impromptue et massive, il y a deux ans, le 16 mars 2020, dans un vaste mouvement de « bricolage » collectif et individuel, qui de façon étonnante a fort bien marché.
47 % des employés ont télétravaillé pendant les confinements en 2020
Chacun en tire les leçons : les salariés ne veulent plus bosser sur un coin de table dans le brouhaha familial, dans l’inconfort du provisoire et les employeurs s’interrogent sur le sens de leur siège, sur leur management des équipes et sur ce qu’il faudra retenir de cet épisode historique.
Les espaces de coworking se sont déployés avec des offres plus ouvertes, plus conviviales, plus transversales. Margot Geay, fait le point sur cette offre qui a changé le paysage économique du centre-ville phocéen. Mais, leurs managers s’interrogent sur la pérennité de ce marché qui tient, Hugues Parant le rappelle dans une tribune, à la prolifération des « autoentrepreneurs intellectuels ». D’autres lieux de coworking verront peut-être le jour, plus près du domicile, mais pas forcément dans les espaces tertiarisés.
Mais le fait majeur c’est la volonté de toutes les familles, à la fois de se rapprocher du lieu de travail et de disposer d’espaces en extérieur si possible, conviviaux, naturels, mais proche des activités commerciales et culturelles. La quadrature du cercle !
La ville du 21e siècle s’invente enfin à Nice et à Marseille
C’est ce défi que relèvent les deux opérations d’intérêt national, OIN, qui s’édifient à l’est et à l’ouest de notre région : Euroméditerranée à Marseille et Nice Eco-vallée sur la Côte d’Azur. Sur ces deux territoires, qui bénéficient d’un management unique, cohérent, planifié, public, la volonté est bien de mixer, d’hybrider, de croiser les fonctionnalités territoriales. Nous rompons, enfin avec la spécialisation fonctionnelle, qui a écartelé nos villes. Jean-Pierre Largillet, notre partenaire et correspondant à Sophia-Antipolis, nous révèle ainsi comment la ville de Nice reprend le leadership économique dans le département grâce à un éco quartier qui s’installe dans une zone ingrate. L’Établissement public Euroméditerranée a lui aussi, depuis sa création, mis en œuvre une planification qui fait place au logement comme aux bureaux, aux espaces publics, aux équipements de loisirs. Il est en train de s’inventer aux deux extrémités de la région, une nouvelle façon de faire la ville, de rendre attractif, non plus simplement un bâtiment, mais un quartier et de relier ces « villes nouvelles » avec leurs centres historiques.
Les entrepreneurs-aménageurs : une offre novatrice de qualité de vie au travail
Enfin dans ce paysage des aménageurs, femmes et hommes du public, professionnels de l’acte de bâtir, s’invitent les entrepreneurs, qui veulent faire de leur lieu de travail des lieux de vie. Nous ne retournons pas aux maîtres de forges qui construisaient des « cités » avec les maisons des ouvriers, les villas des cadres, l’église, l’école et la mairie. Nous sommes face à une offre novatrice de qualité de vie au travail, un positionnement neuf, une volonté de créer un écosystème créatif et attractif. Richard Michel nous entraîne dans ces projets audacieux.


![[Hors-série] Ce qui change dans l’immobilier de bureau : les nouvelles adresses des entreprises](https://gomet.net/wp-content/uploads/2022/04/une_hs_immo-750x375.jpg)

![[Agenda] Aix-Marseille Provence : que faire ce week-end des 25, 26 et 27 avril ?](https://gomet.net/wp-content/uploads/2025/04/rubrique-agenda-we-1-1140x570-1-120x86.png)