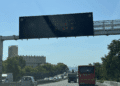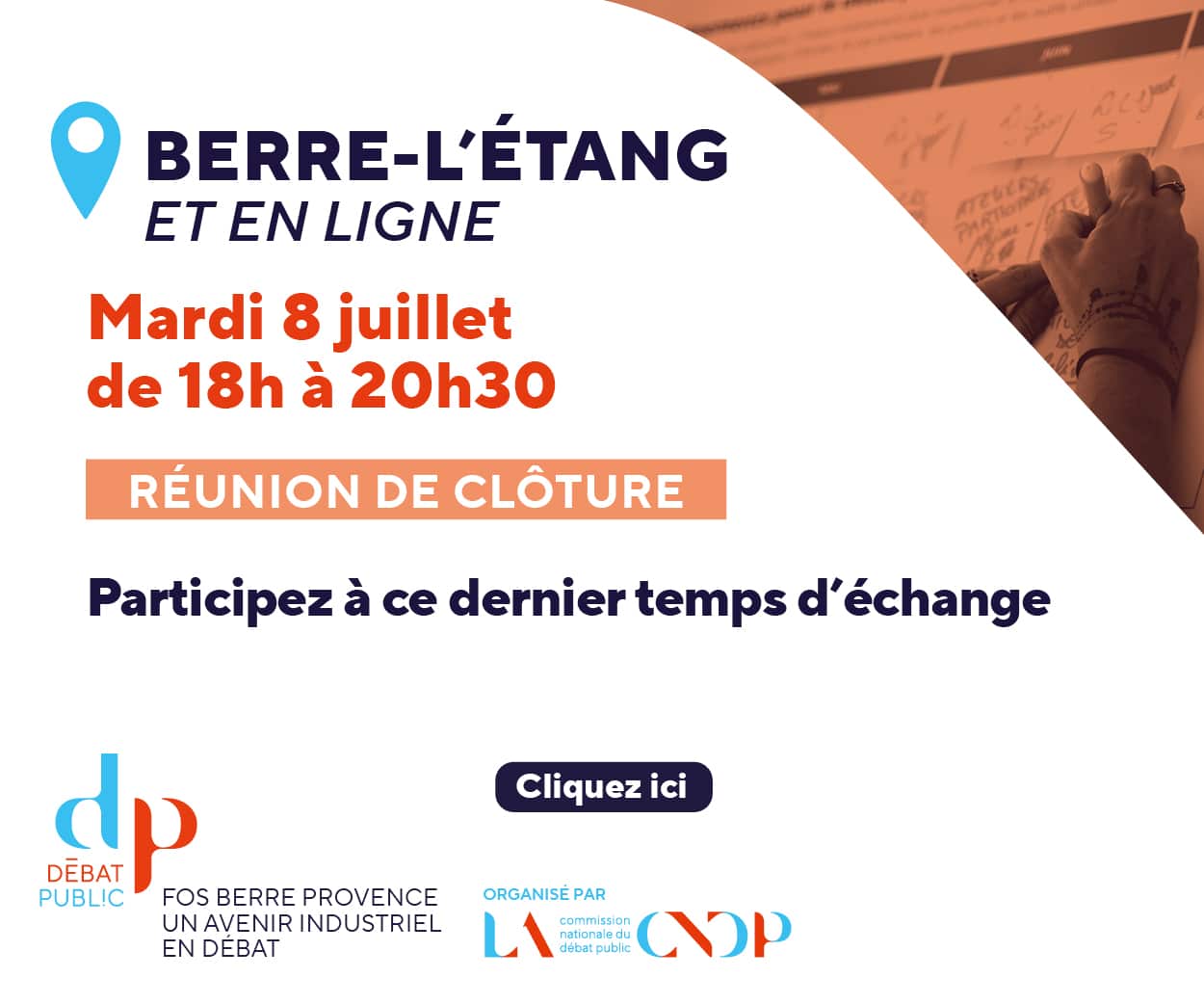Renaud Vignes est docteur en sciences économiques et maître de conférences à l’IUT d’Aix-en-Provence. Auteur du livre « L’impasse » paru en décembre, il était présent jeudi 6 juin pour discuter du monde et du travail de demain dans le cadre d’une conversation organisée par la Fédération des entreprises d’insertions. Pour l’auteur, la société techno-capitaliste a atteint une impasse : le marché sans contrainte a créé des puissances monopolistiques sans précédent aux dépens des institutions sociales. Il introduit un nouvel élément, la déformation sociale du temps, pour nous aider à comprendre le travail et le monde de demain.
Comment est née votre réflexion autour du temps dans notre société que vous qualifiez de techno-capitaliste ?

R. V. C’est de mon expérience personnelle qu’est venue la thèse de mon livre « L’impasse ». La rencontre entre la start-up et la recherche académique. Le temps court et le temps long. Deux univers que je connais bien puisque j’évolue dans le système universitaire mais j’ai aussi créé deux start-up que j’ai ensuite revendues.
Ce dont je me suis aperçu c’est qu’effectivement, introduire la déformation sociale du temps permet de comprendre le nouveau monde. C’est-à-dire une transformation du temps, un temps qui se raréfie, qui prend de la valeur, qui se comprime, ce qu’on vit tous les jours. Il faut aller de plus en plus vite. C’est une notion qu’a développée Garry Becker, prix Nobel d’économie en 2002.
C’est un vrai projet politique lié à la globalisation. Plus on s’éloigne, plus on doit se déplacer vite par exemple. Emmanuel Macron est en plein dedans.
Hors le monde a toujours évolué selon une dialectique. Le monde que j’ai connu c’est le monde social-démocrate, l’Etat-providence, en fait une dialectique entre la puissance du capitalisme qui est un système très puissant mais qui était confronté a des institutions sociales. Maintenant, les firmes sont devenues des puissances monopolistiques sans équivalent dans l’histoire grâce a un marché sans contrainte. Il faut renouer avec le libéralisme historique plutôt qu’avec sa caricature.
Vous dites que les institutions perdent énormément de pouvoir face au modèle de la start-up. Doit-on placer à nouveau la société et les institutions au cœur des préoccupations ?
R. V. Ce qui a été ne reviendra pas. On sent bien que le modèle de l’époque, l’Etat-providence est fini sous sa forme historique. Les gens ne pensent pas de la même manière, ils sont plus individualistes qu’avant. Mais par contre ce qui a pris la place de la dialectique de l’époque, c’est le temporel. Les forces qui accélèrent sont ultra-puissantes face à des forces qui ralentissent.
Dans le monde de la nouvelle économie, on dit « the winner takes all » [le gagnant prend tout, NDLR]. Et donc la seule stratégie viable pour une entreprise c’est d’aller extrêmement vite pour atteindre une position de monopole. On est toujours dans de la vitesse, sinon on est marginalisé.
En face il y a une faiblesse des forces qui ralentissent, puisque ce sont des institutions. Élever des enfants c’est lent. Faire de la recherche c’est lent. La justice c’est lent. En ce moment, le rapport de forces bascule clairement vers les forces d’accélérations.
Il n’y a pas tout à jeter dans ces forces puissantes. La technologie a apporté des progrès, la globalisation a fait sortir des centaines de millions de personnes de la misère etc. Je ne suis pas un révolutionnaire.
C’est une sorte d’engrenage et personne n’est capable de dire, avec un engin d’une telle puissance lancé à toute allure, ce qui va se passer. C’est pour cela que je parle d’impasse dans mon livre. Si on tire les leçons du passé, c’est toujours lorsque les dialectiques ont été correctement équilibrées que le monde s’est le mieux porté. L’idée pour moi de ce qui pourrait être un vrai projet politique -radical mais pas révolutionnaire- ce serait de reconstruire une dialectique qui permettrait de rééquilibrer ces forces. Puisque le problème c’est trop loin et trop vite, ralentissons et rapprochons. Comprenons-nous bien, je ne vois pas un monde replié sur soi pour autant.
Renaud Vignes est docteur en sciences économiques et maître de conférences à l’IUT d’Aix-en-Provence. Auteur du livre « L’impasse » paru en décembre, il était présent jeudi 6 juin pour discuter du monde et du travail de demain dans le cadre d’une conversation organisée par la Fédération des entreprises d’insertions. Pour l’auteur, la société techno-capitaliste a atteint une impasse : le marché sans contrainte a créé des puissances monopolistiques sans précédent aux dépens des institutions sociales. Il introduit un nouvel élément, la déformation sociale du temps, pour nous aider à comprendre le travail et le monde de demain.
Comment est née votre réflexion autour du temps dans notre société que vous qualifiez de techno-capitaliste ?

R. V. C’est de mon expérience personnelle qu’est venue la thèse de mon livre « L’impasse ». La rencontre entre la start-up et la recherche académique. Le temps court et le temps long. Deux univers que je connais bien puisque j’évolue dans le système universitaire mais j’ai aussi créé deux start-up que j’ai ensuite revendues.
Ce dont je me suis aperçu c’est qu’effectivement, introduire la déformation sociale du temps permet de comprendre le nouveau monde. C’est-à-dire une transformation du temps, un temps qui se raréfie, qui prend de la valeur, qui se comprime, ce qu’on vit tous les jours. Il faut aller de plus en plus vite. C’est une notion qu’a développée Garry Becker, prix Nobel d’économie en 2002.
C’est un vrai projet politique lié à la globalisation. Plus on s’éloigne, plus on doit se déplacer vite par exemple. Emmanuel Macron est en plein dedans.
Hors le monde a toujours évolué selon une dialectique. Le monde que j’ai connu c’est le monde social-démocrate, l’Etat-providence, en fait une dialectique entre la puissance du capitalisme qui est un système très puissant mais qui était confronté a des institutions sociales. Maintenant, les firmes sont devenues des puissances monopolistiques sans équivalent dans l’histoire grâce a un marché sans contrainte. Il faut renouer avec le libéralisme historique plutôt qu’avec sa caricature.
Vous dites que les institutions perdent énormément de pouvoir face au modèle de la start-up. Doit-on placer à nouveau la société et les institutions au cœur des préoccupations ?
R. V. Ce qui a été ne reviendra pas. On sent bien que le modèle de l’époque, l’Etat-providence est fini sous sa forme historique. Les gens ne pensent pas de la même manière, ils sont plus individualistes qu’avant. Mais par contre ce qui a pris la place de la dialectique de l’époque, c’est le temporel. Les forces qui accélèrent sont ultra-puissantes face à des forces qui ralentissent.
Dans le monde de la nouvelle économie, on dit « the winner takes all » [le gagnant prend tout, NDLR]. Et donc la seule stratégie viable pour une entreprise c’est d’aller extrêmement vite pour atteindre une position de monopole. On est toujours dans de la vitesse, sinon on est marginalisé.
En face il y a une faiblesse des forces qui ralentissent, puisque ce sont des institutions. Élever des enfants c’est lent. Faire de la recherche c’est lent. La justice c’est lent. En ce moment, le rapport de forces bascule clairement vers les forces d’accélérations.
Il n’y a pas tout à jeter dans ces forces puissantes. La technologie a apporté des progrès, la globalisation a fait sortir des centaines de millions de personnes de la misère etc. Je ne suis pas un révolutionnaire.
C’est une sorte d’engrenage et personne n’est capable de dire, avec un engin d’une telle puissance lancé à toute allure, ce qui va se passer. C’est pour cela que je parle d’impasse dans mon livre. Si on tire les leçons du passé, c’est toujours lorsque les dialectiques ont été correctement équilibrées que le monde s’est le mieux porté. L’idée pour moi de ce qui pourrait être un vrai projet politique -radical mais pas révolutionnaire- ce serait de reconstruire une dialectique qui permettrait de rééquilibrer ces forces. Puisque le problème c’est trop loin et trop vite, ralentissons et rapprochons. Comprenons-nous bien, je ne vois pas un monde replié sur soi pour autant.