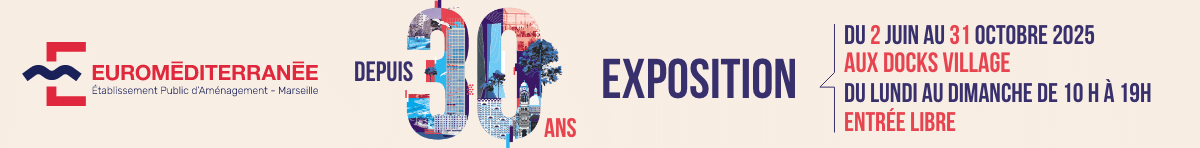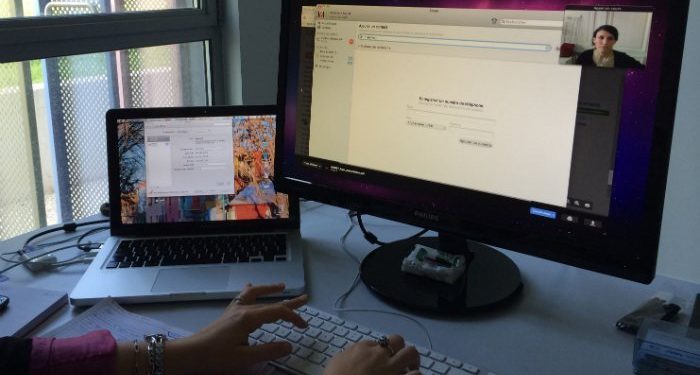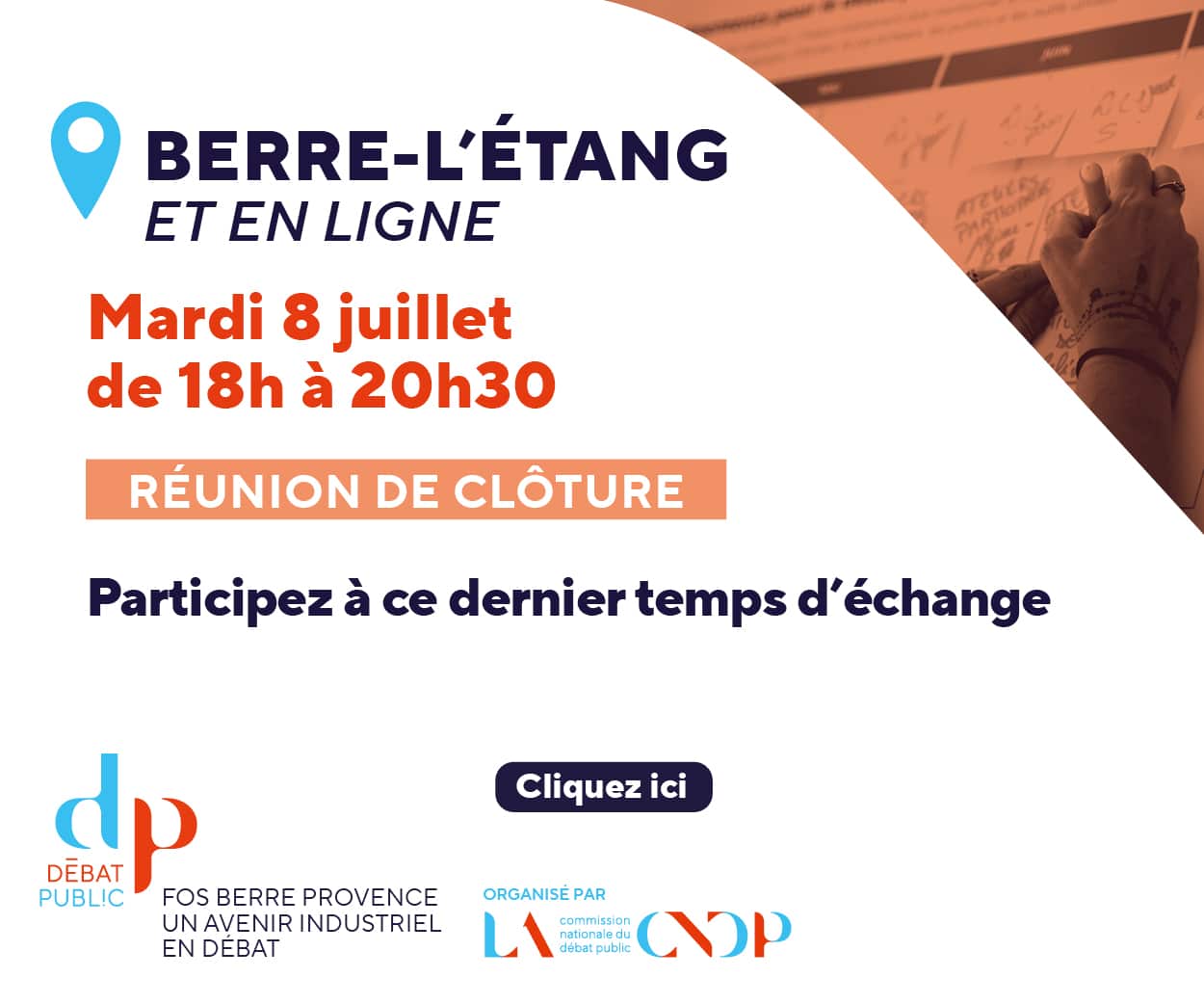En ce mois de janvier 2018, la ville de Marseille lance les premiers travaux de son big data de la tranquillité publique. Un vaste projet innovant de «data science » qui veut extraire de l’ensemble des informations de sécurité collectées par les agents de terrain des enseignements jusque-là imperceptibles.
«J’entends qu’on ait des solutions pratiques: combien d’agents, combien de barrières, à quelle heure… » Avec son «big data de la tranquillité publique », c’est un projet unique que met en place la Mairie de Marseille, capable d’analyser des quantités colossales de données publiques existantes et d’en extraire en continu des aides à la décision pouvant s’avérer précieuse. L’objectif formulé initialement par Caroline Pozmentier, l’adjointe au maire de Marseille en charge de la sécurité publique et de la prévention de la délinquance, correspond en fait à une des multiples petites briques rendues possible par cet outil informatique d’un nouveau type, allant piocher partout, des mains courantes aux données de la RTM ou de l’AP-HM, les informations permettant d’identifier tous les «signaux faibles » de la sécurité publique.
1,5 million d’euros de budget
L’histoire du big data de la tranquillité publique commence en 2014. «Nous nous sommes dits qu’il fallait mieux travailler, grâce au numérique, explique Caroline Pozmentier, le fait d’avoir de nombreux chantiers, d’être une plaque tournante de l’évènementiel, tout cela a un impact sur la sécurité. Nous avons donc lancé un marché de consultation qui s’est concrétisé par une étude réalisée par Thalès sur la sécurité aux abords des écoles primaires, étude qui s’est avérée convaincante”. Dès lors, la ville a cherché des partenaires financiers pour mettre en place un projet de big data, d’analyse de la quantité colossale de données liées à la sécurité générées par les services de la ville et les services publics et parapublics au sens large. Fin 2016, c’est un budget de 1,5 million d’euros qui est débloqué, dont 600 000 euros issus du département et 600 000 euros provenant des fonds européens Feder, grâce au soutien de la Région Sud.
En parallèle, les tests se poursuivent. « En juin 2016, nous avons fait réaliser une maquette big data sur l’accidentologie, poursuit Caroline Pozmentier, Engie nous a conçu un POC [Proof Of Concept, démonstration de faisabilité, ndlr] très révélateur. On leur a, par exemple, donné les informations issues des centres de supervision urbain, qu’ils ont su analyser pour montrer l’importance de modifier les plans de circulation ».
Un groupement chapeauté par Ineo Digital
Fin novembre 2017, le projet est officiellement lancé avec l’annonce de son attribution à un groupement chapeauté par Ineo Digital, une entité d’ENGIE Ineo. On y retrouve Oracle, en charge de la plateforme technologique et des bases de données, et deux sociétés métropolitaines, Jaguar Network, responsable de l’infrastructure réseaux, et Data2i, pour la partie data science.
La société Sur&Tis en fait aussi partie, avec une mission bien particulière de facilitateur. « Dans ce groupement, il y a de nombreux spécialistes de la donnée, nous intervenons au titre de notre expertise métier en matière de sécurité, explique Emmanuel Magne, le directeur général de la société sur la région. Nous allons servir d’interface une fois les demandes opérationnelles exprimées, pour que le produit créé soit le plus adapté possible aux besoins métier, qu’il ait une approche métier”.
En parallèle, de nombreux «fournisseurs de données » se sont joints au projet. L’observatoire sera en effet alimenté non seulement par les données des services de la ville mais aussi par les informations de nombreux partenaires. «Dans un projet de big data, nous essayons de trouver des corrélations, d’identifier des facteurs d’explication de la situation, explique Sébastien Vinant, directeur innovation d’Ineo Digital. Par exemple, pour un accident de vélo, est-ce qu’on est à un carrefour, à quelle heure, est-ce que l’éclairage public était opérationnel,… Nous croisons alors ces données pour voir lesquelles ont eu un impact réel.»
D’où l’importance d’obtenir des informations les plus variées possibles pour identifier des facteurs d’influence insoupçonnés. «Nous allons travailler sur des données qui viendront de nombreux partenaires, dans le transport, la propreté, plus globalement les opérateurs de services urbains. On peut ainsi imaginer se faire une idée de la sociologie d’un quartier via les données en open data de l’Insee».
L’observatoire de la tranquillité publique se distingue ainsi fortement d’autres projets de SmartCity, a l’instar des places connectées d’Aix, qui reposent sur la mise en place de capteurs collectant des données. Mais qui, comme tout nouveau dispositif, demande du temps avant de pouvoir récupérer une masse suffisante d’informations pour se lancer dans une véritable démarche big data.
Une approche progressive
C’est aussi une approche modeste, de pas à pas, qui a été sélectionnée par la Mairie. «La ville veut commencer de façon progressive, elle ne veut pas transformer ce projet en démonstration technologique, poursuit Sébastien Vinant. Elle va donc identifier et prioriser au fur et à mesure les sujets à traiter. A chaque fois, nous vérifierons si un résultat probant est obtenu.»
En même temps que l’analyse, l’observatoire de la tranquillité publique va travailler sur l’accès et la compréhension de l’information. Les services de la ville concernés se verront ainsi fournir des tableaux de bord et des applications dédiés. Des interfaces de programmation pourront aussi aller piocher dans le big data pour alimenter directement les indicateurs des services. Les citoyens disposeront aussi de leur propre action. La ville a clairement énoncé son intention de leur restituer les informations obtenues.
Ces développements informatiques constituent d’ailleurs un débouché important de la plate-forme. «Elle doit avoir un ROI rapide et être interopérable, elle doit permettre à tous les systèmes de bien communiquer, explique Kevin Polizzi, le PDG de Jaguar Networks. Un des plus grands enjeux, ce sera donc de pouvoir réutiliser les applications développées pour un usage futur.» Chez Ineo Digital, on met ainsi en avant l’application Cit’eazen, permettant aux particuliers de signaler des problèmes type panneau de signalisation cassé aux services municipaux, créée pour Lille mais qui pourrait aussi avoir du sens à Marseille.
Anonymat VS « pseudonymisation »
La question de l’anonymat de ces données reste, elle, à trancher. L’ensemble des acteurs du dossier nous a bien précisé que l’observatoire sera parfaitement compatible avec la nouvelle réglementation européenne sur les données personnelles, qui prendra effet en 2018, et avec les demandes de la Cnil. Par contre, autant la mairie insiste sur le fait que les données utilisées seront entièrement anonymes, autant certains des prestataires concernés parlent de « pseudonymisation », technique qui réduit les corrélations mais qui permet si besoin de remonter à l’identité de la personne.
Les premiers résultats de l’observatoire devraient prendre forme rapidement. Des ateliers de définition des cas d’usage vont être organisés en janvier, avec la ville et les prestataires en charge de l’observatoire, mais aussi avec des interlocuteurs tels que la RTM, la SNCF, l’AP-HM ou le Port. « Dès le premier trimestre 2018, au plus tard sur le premier semestre, nous serons en mesure de faire parler l’outil. Les premiers enseignements porteront sur l’évènementiel, au sens large, de la réunion de quartier à la grande manifestation», précise Caroline Pozmentier. Si ce premier livrable s’avère fructueux, l’année 2018 devrait alors être rythmée par les découvertes du big data de la tranquillité publique.
Liens utiles.
> A suivre: Caroline Pozmentier : l’Observatoire de la tranquilité publique est une première brique » (2/2)
> A lire aussi : Sécurité, la stratégie de Marseille pour les trois prochaines années