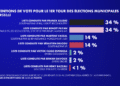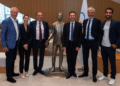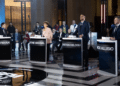Le Plan Bleu poursuit ses travaux sur l’économie bleue et la croissance durables, et vient de publier une Note bleue sur l’énergie éolienne marine. La publication avance des recommandations visant à renforcer durablement le secteur de l’énergie éolienne en Méditerranée. 16 défis (cadres environnementaux, sociopolitiques, économiques et financiers, juridiques et réglementaires et technologiques) sont identifiés comme prioritaires pour le bassin méditerranéen. Robin Degron, directeur du Plan Bleu (Programme des Nations Unies pour l’environnement) en précise l’enjeu dans une tribune pour les lecteurs de Gomet’.
Le débat sur le développement des centrales électriques éoliennes offshore va bon train en France. Il intéresse également l’ensemble des écosystèmes côtiers mondiaux. Au Plan Bleu, centre d’expertise des Nations Unies pour l’environnement en Méditerranée, nous travaillons depuis plusieurs années sur ce thème complexe qui croise des enjeux socio-économiques et environnementaux (cf. notamment notre dernière note sur « Recommendations to enhance Offshore Wind Energy »).
Cette complexité est source de confusion. De quoi parle-t-on ? Quelles sont les externalités produites ? Où prévoit-on les implantations exactement ? Afin de clarifier les discussions et de baliser les investissements financièrement lourds, nécessaires à ce type d’infrastructure, il convient de hiérarchiser les enjeux de manière géographique. La question ne se pose pas dans les mêmes termes à l’échelle mondiale, régionale ou locale d’un projet.
À l’échelle Monde, nous devons nous affranchir de la dépendance aux énergies fossiles.
À l’échelle Monde, il est clair que nous devons nous affranchir de la dépendance aux énergies fossiles. Elles finiront par manquer, ou leurs coûts d’exploitation deviendront prohibitifs d’ici là. Leur combustion génère des émissions de gaz à effet de serre (GES) dont on perçoit qu’ils commencent sérieusement à déséquilibrer le climat, provoquant – ici – des pluies torrentielles comme aux États-Unis et en Europe avec les actuelles tempêtes Milton et Kirk, ou – là – des sécheresses sévères comme, par exemple, au Maroc qui vient d’enchaîner six années de sécheresse consécutives. L’Union européenne est aussi touchée avec 42 °C à Sparte en juin dernier ; 48 °C à l’ombre au cœur de la Sicile mi-juillet 2024.

Le développement d’énergies renouvelables (ENR), en particulier des énergies marines renouvelables (EMR), est une nécessité économique et environnementale pour tenter de réduire, sur le long terme, les émissions de GES. Après un long temps d’inertie (en 2010, le Grenelle de l’environnement prévoyait déjà 6 GW d’éolien offshore d’ici 2020 pour une réalité d’installation en 2022 de seulement 0,5 GW) et en dépit d’une priorité de politique énergétique qui demeure donnée à la production d’électricité électronucléaire, la France a choisi de promouvoir résolument les EMR.
La Stratégie française énergie climat (SFEC), la Stratégie nationale mer et littoral (SNML), qui se décline elle-même à travers les Documents stratégiques de façade (DSF), portent des objectifs ambitieux. Sachant qu’on part pratiquement de zéro, ce sont environ 20 à 30 GW de puissance installée qui sont désormais visés d’ici 2033 ; 40 à 60 GW à l’horizon 2050.
Attention toutefois à ne pas plaquer un objectif général sur des réalités géographiques variées. Il faut garder le sens de la mesure et s’adapter, avec discernement, aux contraintes régionales et locales de manière réfléchie, documentée.
Méditerranée : 20 % de plus de réchauffement que la moyenne Monde
L’échelle régionale doit être considérée en premier lieu au regard des enjeux spécifiques de tel ou tel océan ou mer. La Méditerranée n’est pas l’Atlantique ou le Pacifique. On parle ici d’une mer quasi fermée qui ne couvre que 0,82 % de la surface mondiale des océans, mais qui abrite 7,5% de la faune marine connue et 18% de la flore océanique. La Grande Bleue est par ailleurs exposée à des pollutions et à une augmentation particulièrement sensible de la température avec près de 20% de plus de réchauffement que la moyenne Monde. Le Bassin, ses biotopes et biocénoses, est donc fragile. Ainsi, la préservation des herbiers de Posidonie (Posidonie oceanica), des récifs coralliens, des flux d’avifaune migratoire entre l’Europe et l’Afrique ou des populations de grands mammifères marins (ex. dauphin commun, Delphinus delphis, ou dauphin de Risso, Grampus griseus) revêt-elle, dans cette région, une particulière sensibilité.

Attention donc à ce que les câbles de distribution de l’électricité produite ne labourent pas les fonds marins, à ce que les pâles des éoliennes ne coupent pas les flux du vivant, ni celui des oiseaux migrateurs sur le plan physique, ni celui des cétacés sur le plan acoustique. Notons toutefois qu’un dispositif d’éolienne offshore flottant peut constituer une sorte de récif, porteur d’une certaine biodiversité.
Être particulièrement vigilant, aux effets cumulatifs d’un trop grand nombre d’unités de production dans un même secteur
Dr Robin Degron, directeur du Plan Bleu PAM-PNUE
Les éoliennes posées sur le fond posent davantage de problèmes pour l’environnement, mais elles restent, de toute manière, peu adaptées à une mer Méditerranée rapidement très profonde. Il faut évidemment veiller à ne pas trop, non plus, perturber l’activité de pêche ou de transport maritime et à prendre en compte la qualité des paysages côtiers d’une mer qui attire chaque année environ 400 millions de touristes pour la beauté naturelle de ses rivages. Bref, la Grande Bleue n’est pas une région comme les autres et il faut y être particulièrement vigilant, notamment aux effets cumulatifs d’un trop grand nombre d’unités de production dans un même secteur.
Il est ici question d’aménagement intégré des zones côtières qui sont un enjeu clef de la mise en œuvre de la Convention de Barcelone sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (1976) avec son Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (Protocole GIZC adopté à Madrid, en 2008) et de la Stratégie méditerranéenne de développement durable (SMDD 2016-2025), qui est en cours de révision pour la période 2026-2035.
Éolien en mer : à l’échelle locale, il faut redoubler de vigilance
À l’échelle locale, celle du projet concret, il faut redoubler de vigilance et prendre le temps d’étudier le terrain. Les études d’évaluation environnementale y contribuent. C’est en effet bien là, que se joue l’essentiel et que les interactions potentiellement négatives entre les autres activités de l’économie bleue (cf. pêche, transport, tourisme) et l’environnement marin se matérialisent.
Le besoin de connaissance à cette échelle fine est donc essentiel pour des aménagements bien pensés et effectivement durables qui concilient lutte contre les émissions de GES et préservation des écosystèmes marins au titre de l’Objectif de développement durable ODD n° 14 dédié à la vie aquatique « Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et ressources maritimes aux fins du développement durable ».
Observer, comprendre, se projeter afin de définir une stratégie de développement durable des éoliennes offshore, voilà le message du Plan Bleu qui œuvre pour la préservation dynamique de Mare Nostrum depuis près de cinquante ans.
Robin Degron, directeur du Plan Bleu PAM-PNUE
(Plan d’action pour la Méditerranée du Programme des Nations Unies pour l’Environnement)
Document source : Éolien mer, les recommandations du Plan Bleu
Liens utiles :
Notre dossier d’actualités consacré à l’éolien en mer
Éolien en mer : AO10, Fos-sur-Mer confirmé en hub de la Méditerranée




![[Agenda] Aix-Marseille Provence : que faire ce week-end du 27 février au 1er mars ?](https://gomet.net/wp-content/uploads/2026/02/rubrique-agenda-we-4-120x86.png)