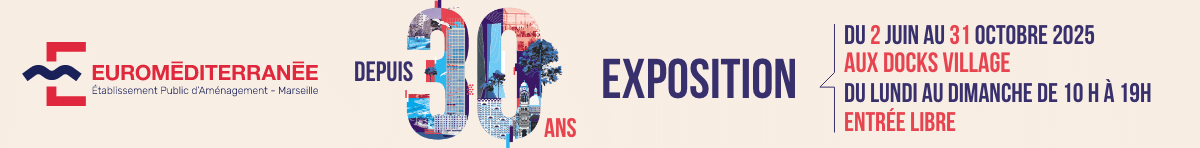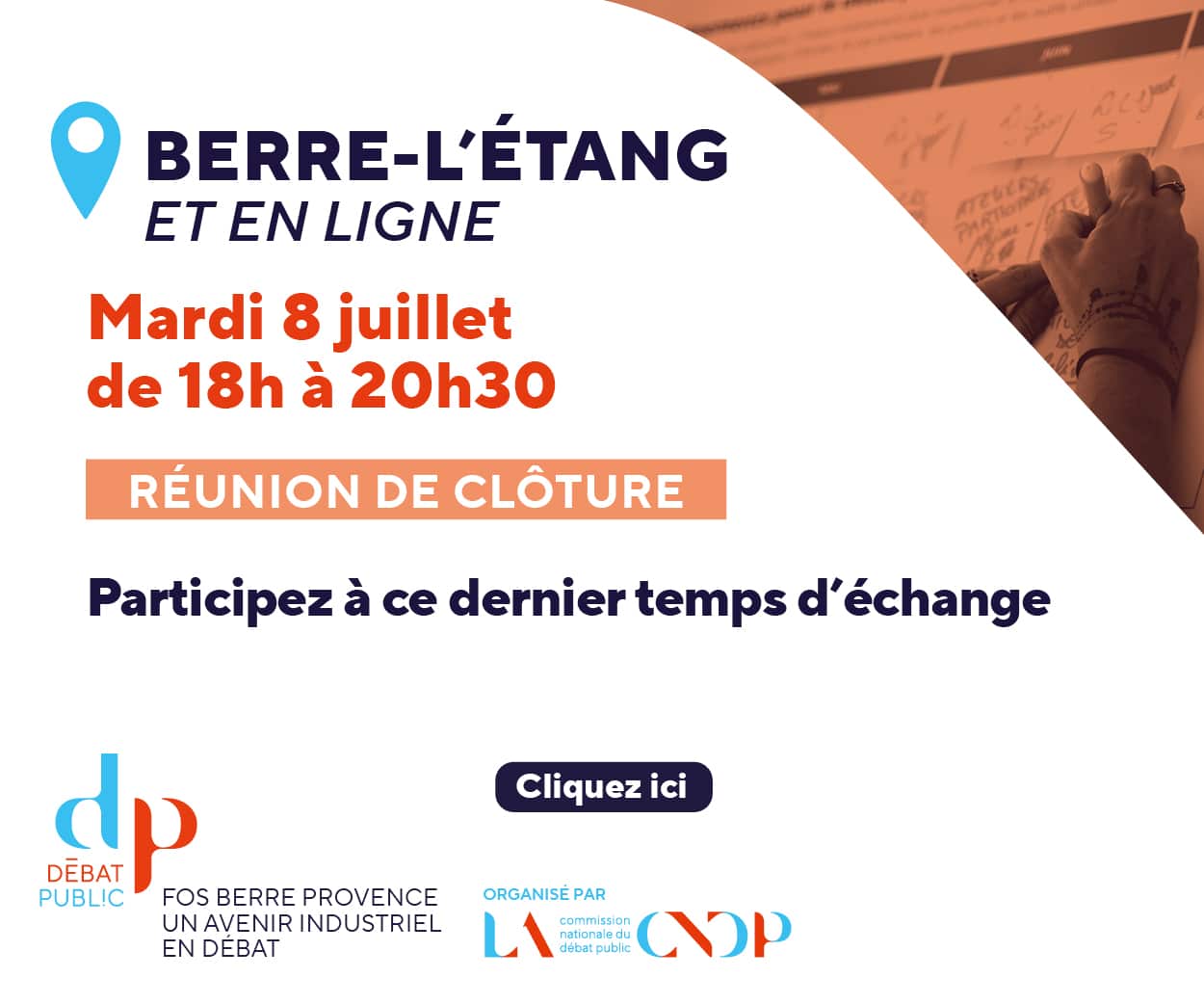Premier des «printemps arabes», le soulèvement tunisien peut, huit ans après son éruption, être perçu comme celui qui a le moins mal évolué. L’Algérie voisine tente actuellement, et avec vigueur, de prendre en mains (propres) son destin; mais en Syrie ou en Libye, en Égypte ou au Yémen, bien des obstacles se dressent encore face au désir d’émancipation des citoyens.
En octobre prochain, puis en décembre, l’électorat tunisien choisira députés et président. Le pays se souvient du sacrifice, neuf ans plus tôt, du jeune diplômé devenu marchand ambulant, Mohamed Tarek Bouazizi, s’immolant par le feu, à 26 ans, en dénonçant un régime corrompu et détesté. Mois d’un mois plus tard, le 14 janvier 2011, malgré les offres incongrues de Paris -de conseil en répression- le président Ben Ali s’envole vers l’Arabie saoudite.
Entre temps, les rues de tout le pays auront donné chair et clameur colorée aux sentiments exaspérés de révolte circulant sur les réseaux numériques. Cette connexion inédite forme la trame du récit proposé en galerie haute du Fort Saint-Jean, en écho à une présentation initiale au musée du Bardo, à Tunis.
Révolution documentée par ses acteurs eux mêmes
Au nom de sa dignité, le peuple issu de Carthage se filme et décrit lui même son courroux. Téléphones portables, sites vidéos , blogs et plateformes relaient en images et moqueries l’enthousiasme révolutionnaire de cet hiver 2010/11. Ce patrimoine numérique, tout virtuel qu’il soit, constitue, pour la première fois, la source majeure d’archives dont disposent aujourd’hui historiens et mémorialistes. Un fonds contenant jusqu’à trois mille documents, dont l’exploitation peut s’avérer complexe.
Autrement dit, la population en colère s’est auto-documentée, sublimant la cyber-dissidence en cyber-affrontement, puis en lutte concrète pour débarrasser le pays de l’oppression et d’une direction honnie. A Kasserine comme à Tunis, notamment, le sang coulera. Près de 3 000 blessés et 334 tués au cours de ces 29 jours volcaniques. Et le pouvoir haï finira par tomber.
En dépit d’un certain désenchantement social, la Tunisie se donnera en 2014 une nouvelle constitution, appréciée comme l’une des plus progressistes du monde arabe. Une véritable ferveur citoyenne , connectée aux nuages digitaux, aura ainsi eu raison de l’injustice et des abus de pouvoir. Ce message salutaire devrait inciter tous les adeptes des lumières à partager au Mucem ce moment tunisien-libérateur.
Repère :
Instant tunisien, Archives de la révolution
> Du 20 mars au 30 septembre 2019
> Tous les jours sauf le mardi, de 11 à 18 h
> Plus d’infos : www.mucem.org> Un temps fort sera organisé les 3, 4 et 5 mai : “Travail, Dignité, liberté ! Huit ans après la révolution tunisienne ». En écho à l’exposition, le Mucem propose trois journées pour interroger la Tunisie contemporaine à la lumière de son histoire, mais aussi à travers les témoignages de celles et ceux qui, aujourd’hui encore, œuvrent à l’émergence d’une société démocratique dans un pays où les acquis de la révolution restent fragiles. Avec ce programme mêlant tables rondes, conférence, performances et projections, il s’agit notamment d’interroger l’émergence de la citoyenneté (par le droit, mais aussi par l’accès à l’information), ainsi que la réappropriation de l’espace public par les Tunisiens (de la manifestation au street art), huit ans après ce soulèvement populaire inédit. Le détail du programme avec les intervenants.