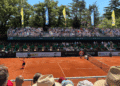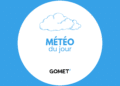L’économie bleue est à la fois une ressource immense, celle qui nous vient de la mer, et un risque, celui de surexploiter les océans, de nuire à la biodiversité et à la planète. Comment le Pôle mer vit-il cette contradiction ?
Christophe Avellan : Nos membres ne se posent pas la question en ces termes. L’économie bleue a une définition européenne (1). Avant cette définition de 2007, on parlait d’industrie navale, de ports, de transports, de pêche. On ne considérait pas la valeur économique du patrimoine ou de la biodiversité. C’est l’effet papillon, rien ne peut se faire sans avoir un impact sur autre chose et l’on doit considérer l’ensemble des activités et leurs interactions. Trop de trafic maritime dans une zone de pêche peut détériorer les stocks de pêche. Trop de pêche détériore le patrimoine touristique et environnemental et la biodiversité. L’économie bleue recherche l’équilibre.

On ne peut pas aujourd’hui développer des projets en R & D qui risquent de se heurter à une réglementation nouvelle dans 2, 3 ou 4 ans. Les entreprises intègrent dans leurs projets la réduction de l’impact environnemental. Au Pôle mer, nous avons les acteurs industriels de la filière, mais aussi des scientifiques et des économistes, des chercheurs, qui protègent l’environnement. On ne se pose pas la question du trop ou pas assez, on va toujours vers le mieux.
Quels sont les points forts de cette économie bleue dans notre région ?
C. A. : La région a une économie maritime historique depuis les Grecs ou les Phéniciens ! Ce qui fait la force de ce territoire, ce sont depuis plus de 2000 ans les échanges par la mer. Ensuite, il y a eu des décisions stratégiques d’implantation portuaires comme Marseille-Fos. Nous sommes héritiers d’un outil industriel économique important. Il reste fragile car il y a toujours des pressions pour le limiter. Prenons un seul exemple, celui de la forme 10 dans les bassins est de Marseille. Elle a été créée, pour construire et réparer des bateaux. Certains ont voulu la combler pour en faire un port à sec, pour construire une marina, ou pour faire une super piscine ! Mais finalement, le maintien de cet outil industriel permet aujourd’hui d’accueillir les plus gros bateaux du monde. La forme 10 reste un outil industriel fort. C’est pareil pour la Ciotat, Toulon, Saint Mandrier ou La Londe. S’il y avait eu des projets immobiliers d’aménagement littoral, on n’aurait pas pu vivre cette réindustrialisation. Le fait d’avoir gardé une orientation industrielle à des outils qui semblaient parfois obsolètes est aujourd’hui un atout.
Le patrimoine foncier littoral industriel est fondamental pour avoir une économie maritime.
Christophe Avellan
Notre région bénéficie d’une très forte densité économique et d’une situation géoéconomique cruciale sur un axe qui va de Barcelone à Anvers. Le brassage de différentes cultures, ce carrefour des idées, des besoins, des échanges, génère des besoins donc du business.
Comment l’économie maritime a-t-elle passé la crise du Covid ?
C. A. : L’économie maritime est résiliente. L’entreprise maritime globalement a maintenu son activité puisque 90 % de ce que nous consommons passe par la mer et par un conteneur. Les entreprises ont fait le dos rond, elles ont gardé leurs salariés, elles se sont adaptées et elles sont reparties. Même si le recrutement reste un sujet très important pour les entreprises. Le Pôle mer a aujourd’hui plus d’adhérents qu’avant le Covid !
Quels sont les secteurs où le Pôle mer joue un rôle moteur dans l’innovation ?
C. A. : En 2007, j’ai instruit les premiers projets d’éoliennes flottantes pour le Pôle mer, avec des collègues de Bretagne. Nous étions alors principalement dans l’oil et gas avec l’envoi de robots pour aider l’industrie pétrolière ! On nous disait qu’il était délirant d’imaginer de telles machines en mer. Aujourd’hui, elles sont dans l’eau !
La restauration écologique, il y a 5, 6 ans, 7 ans, était un sujet de spécialistes. Les entreprises qui développaient des abris à poissons, des « gentils ». Aujourd’hui, rien ne se fait sans avoir un impact positif mesuré sur l’environnement et on vient les chercher. Nous avons défriché ces terrains-là, en allant chercher au niveau du pôle des subventions de l’État, de la région, de l’Europe. Nous travaillons en ce moment sur les microalgues. Il y a un potentiel scientifique immense de cette ressource biotech, qui demande des années de recherche, d’investissements, de création. L’enjeu est notre souveraineté alimentaire et notre souveraineté pharmaceutique.
On est probablement à l’aube d’une nouvelle génération de solutions pour se nourrir, pour se vacciner, pour se soigner, pour nourrir et soigner les animaux. L’aquaculture a muté par exemple, elle captait des petits poissons pour nourrir les gros ! Aujourd’hui les fermes aquacoles sont alimentées avec des protéines végétales issues des micro-organismes marins ou terrestres.
Sur le marché des éoliennes en mer, sommes-nous dans le jeu ?
C. A. : Je suis admiratif de l’effort consenti par les entreprises depuis des années, elles travaillent avec les grands acteurs de l’énergie pour convaincre l’État d’avancer sur les projets d’installation de ferme offshore.
Elles sont toujours là, elles ont beaucoup investi. Nous attendons les résultats de l’appel d’offres pour les premiers sites. Il y a largement de quoi occuper tout le monde pendant plusieurs années. Et puis après, il y a tout le marché qui s’ouvre en Méditerranée. Il y a une compétition sévère, les Américains avancent, les Anglais avancent, les Chinois avancent aussi dans tous les domaines. La France n’est pas en retard, on est dans une très bonne perspective territoriale. Le marché, est considérable et tout ce qui se fait en région a de grandes chances de pouvoir s’exporter et se développer.
Avons-nous les talents pour développer cette économie bleue ?
C. A. : Le Pôle réalise des diagnostics territoriaux des emplois et des compétences, des GPECT. Le dernier paru porte sur l’éolien flottant, celui sur la robotique et les grands fonds marins est en cours. Le contexte est similaire à ce qu’on trouve partout en France, les entreprises peinent à recruter. Les marchés sont tendus. Les établissements d’enseignements ont des consignes pour augmenter le nombre d’étudiants ou de diplômés à mettre sur le marché, mais certains ont de la peine à trouver des formateurs qualifiés pour former aux enjeux des entreprises. Le Pôle travaille sur l’adéquation complète des formations aux besoins des entreprises, avec les universités, les écoles d’ingénieurs, les centres de formation. C’est un travail de fond. Il n’y a pas d’avenir s’il n’y a pas d’emplois qualifiés dans ces entreprises. J’ai une personne dans l’équipe sur le volet emploi et formation. Les entreprises ont besoin d’individus pluridisciplinaires, en tout cas avec un regard ouvert, il faut pouvoir discuter avec tous les acteurs de l’écosystème ; ce sont des profils très recherchés.
(1) L’économie bleue de l’Union englobe tous les secteurs et toutes les industries liés aux océans, aux mers et aux côtes, qu’ils relèvent directement du milieu marin (comme le transport maritime, la fourniture de produits de la mer ou la production d’énergie) ou du milieu terrestre (comme les ports, les chantiers navals ou les infrastructures côtières). Selon le dernier rapport sur l’économie bleue, les secteurs traditionnels de l’économie bleue fournissent 4,5 millions d’emplois directs et génèrent plus de 650 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

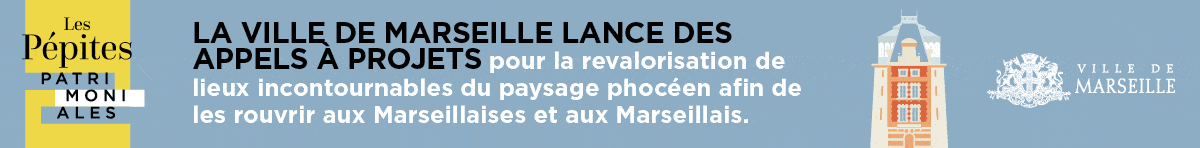

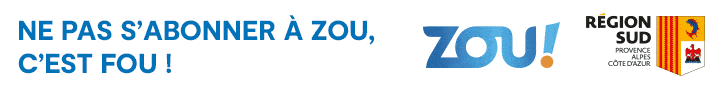



![[Agenda] Aix-Marseille Provence : que faire ce week-end des 25, 26 et 27 avril ?](https://gomet.net/wp-content/uploads/2025/04/rubrique-agenda-we-1-1140x570-1-120x86.png)