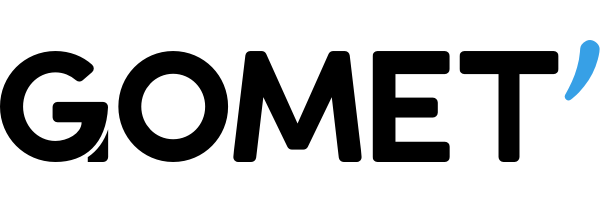Sélectionné dans la section « Un certain regard » à Cannes l’année dernière, le film Salem, tourné à Marseille, est sorti dans les salles le mercredi 29 mai. Nous avons rencontré Jean-Bernard Marlin le mois dernier, à l’occasion de la présentation du film en avant-première dans plusieurs salles de la cité phocéenne. Entretien exclusif pour Gomet’.
Après le succès retentissant de Shéhérazade (le film a été multi-récompensé et triplement césarisé en 2018), on attendait le réalisateur Jean-Bernard Marlin dans un second long-métrage entièrement ancré dans le réel. Finalement, le cinéaste d’origine marseillaise dépasse les frontières et nous livre un film-parabole, sous le titre évocateur de Salem – paix en arabe. Une fable captivante, si tant est que l’on accepte de voyager entre réel et récit fantastico-mystique. Le casting, composé d’acteurs et d’actrices non professionnels, est d’autant plus convaincant qu’il apporte de la force et de la crédibilité aux personnages qui nous touchent particulièrement.

Divisée en trois chapitres clairement titrés, Salem relate l’histoire d’un amour impossible, entre deux adolescents issus de deux communautés rivales, dans les quartiers nord de Marseille. Djibril, un jeune comorien de la cité des Sauterelles et Mélissa, une jolie gitane de son lycée, de la cité des Grillons. Lorsqu’elle lui apprend qu’elle est enceinte, Djibril lui demande d’avorter pour éviter la guerre des clans. Mais l’assassinat d’un ami de Djibril sous ses yeux, va embraser les deux cités. Traumatisé, Djibril, sombre peu à peu dans la folie. Il est persuadé qu’une malédiction s’est abattue sur le quartier et décide à tout prix de garder son enfant : pour lui seule sa fille pourra les sauver du chaos.
Qu’est-ce qui vous a inspiré ce drame shakespearien au sein des communautés comorienne et gitane ?
Jean-Bernard Marlin : À la base, le point de départ du film, ce n’était pas du tout cela. C’était plutôt mon père. J’avais envie de parler de son rapport à l’invisible et aussi de la transmission. Quel monde intérieur transmet-on à son enfant quand on a un rapport avec l’au-delà assez fort, un pouvoir de guérison et un délire mystique ? Ensuite, je voulais ancrer cette histoire à Marseille, la ville dans laquelle j’ai grandi. Quant au choix des communautés gitane et comorienne, elles sont très peu représentées et, d’un point de vue social, ce sont celles qui souffrent le plus dans les quartiers nord de Marseille. Mon père a vécu lui aussi plusieurs années en caravane, c’est pour cela que le motif de la caravane est très présent dans le film. Après, j’adore les tragédies shakespeariennes, j’ai donc essayé de travailler le motif de la tragédie dans le film, notamment les histoires de famille.
Vous-même, avez-vous grandi dans les cités ?
Jean-Bernard Marlin : Non, mais j’y allais régulièrement. J’ai grandi dans des bâtiments en dur, dans le 12e et le 13e arrondissement de Marseille, à côté des cités. Je connaissais bien cet univers, mais je n’ai pas le parcours d’un jeune de cité.
Après le film Shéhérazade, en quoi cela vous tenait-il à cœur de revenir sur le parcours chaotique de ces adolescents ?
Jean-Bernard Marlin : L’aspect social m’intéresse. J’ai envie de défendre cela, comme je le fais en prenant des acteurs non professionnels, issus des quartiers. Eux aussi ont droit à la réussite, autant que quelqu’un qui vient d’un milieu aisé. Ce sont des gens qui sont invisibilisés. Vraiment, on ne rêve même pas de faire du cinéma quand on vient d’un milieu défavorisé !

À propos des acteurs non professionnels, comment vous y prenez-vous ? Leur faites-vous lire le scénario, et quelles sont leurs réactions ?
Jean-Bernard Marlin : Je leur relate l’histoire, mais je ne la dévoile pas complètement pour qu’ils aient la surprise des événements. En général, je leur raconte les moments clés qu’ils doivent connaître afin d’éviter les mauvaises surprises. De toute façon, ceux à qui je donne le texte ne le lisent pas (dit-il en riant).
Justement, quand vous leur expliquez, est-ce qu’ils adhèrent au projet ?
Jean-Bernard Marlin : Ni l’un, ni l’autre. Je n’ai jamais vu un jeune adhérer à un projet en disant : « Je veux faire cela ». Non. Ils adhèrent à un personnage pour de multiples raisons, comme celle de vouloir jouer le rôle de voyou, par exemple. Dans ce cas, je leur explique en quoi le personnage est plus complexe, s’il a des problèmes, des fragilités. La plupart des acteurs non-professionnels ont envie de jouer des personnages beaux, forts, alors que nous, ce qui nous touche au cinéma, c’est tout l’inverse. Ce sont des personnages vulnérables avec leurs faiblesses et leurs défauts. C’est cela qui est intéressant au cinéma ou dans les tragédies.
Ce qui est désarmant dans le film, c’est le paradoxe de ces jeunes d’une grande maturité en raison de la violence quotidienne, mais qui gardent un côté enfantin. Je pense notamment à cette scène, qui va tourner au drame, dans laquelle l’ami de Djibril lui montre une cigale emblématique, qu’il porte telle un trophée, comme un gamin jouerait avec une coccinelle. Comment vous est venue cette idée ?
Jean-Bernard Marlin : Ça, c’est vraiment dans l’écriture. C’est pour cela que j’ai essayé de vraiment m’affranchir un peu du documentaire, par rapport à Shéhérazade où j’étais beaucoup dans le réel, même s’il y avait un vrai travail de l’imagination. Dans Salem, j’ai vraiment poussé pour mettre des éléments qui ne sont pas forcément ancrés dans le réel, mais très fictionnalisés, que l’on ne voit pas forcément dans ce genre de film.
Justement, le film glisse peu à peu vers le cinéma fantastique jusqu’à la scène finale apocalyptique. Cela correspond-il à une volonté de vous émanciper de l’étiquette de cinéaste du réel ?
Jean-Bernard Marlin : Exactement. Et le prochain, sera encore différent. Cela m’intéressait aussi de prendre des risques narratifs, dans ce cinéma-là en particulier. Je voulais prendre le contre-pied de Shéhérazade. Je me suis dit : « Je vais faire l’inverse. Je vais essayer de faire un truc très fictionnalisé pour essayer autre chose. » Parce que sinon, en tant que cinéaste, je ne vais pas progresser, je vais m’endormir.
Le film marseillais Shéhérazade triplement récompensé aux Césars
De même que vous n’hésitez pas à parler de la spiritualité de Djibril qui porte une croix et une main de Fatma autour du cou. Qu’est-ce qui vous a amené à traiter du syncrétisme religieux ?
Jean-Bernard Marlin : Déjà, j’ai étudié l’histoire des religions, je trouve cela passionnant. J’ai beaucoup étudié la religion chrétienne et la religion musulmane. Je n’ai pas encore eu l’occasion d’étudier la religion juive, mais j’aimerais bien. Mais il y a un socle commun dans les deux religions. Du reste, quand on étudie l’histoire des religions, c’est quasiment la même chose, sauf que les textes n’ont rien à voir. Mais on a les mêmes prophètes, les mêmes préceptes, les mêmes commandements, les mêmes principes moraux.
Là encore, vous prenez un risque. Ne craignez-vous pas de vous attirer les foudres en abordant la religion, sujet devenu tabou aujourd’hui ?
Jean-Bernard Marlin : Dans les années 70, c’était le sexe qui était tabou ! (dit-il en riant). Personnellement, j’ai été nourri à la lecture religieuse. Évidemment, à la fin, avec l’invasion des cigales, on pense à la tornade, à Moïse, mais il y a une dimension plus spirituelle que religieuse dans mon film, parce qu’au final, je ne traite pas de la religion.
Pourtant, dans la scène où l’ami de Djibril lui dit que la cigale est capable de deviner si Camilla est enceinte ou pas, on pourrait y voir une parabole de l’Annonciation ?
Jean-Bernard Marlin : Je n’ai pas pensé à l’Annonciation, mais quand j’ai écrit, j’ai pensé à Marie en me disant que dès l’instant que l’enfant était dans le ventre de sa mère, il était conscient que c’était un enfant élu. Mais je voulais que cela reste subtil.
Le film se termine par une scène apocalyptique. Votre prochain sera-t-il dans le même esprit No future ?
Jean-Bernard Marlin : Pour moi, celui-ci n’est pas complètement No future ! (dit-il en riant). Pour moi, il y a un message de paix. Elle sauve Djibril à la fin, elle le guérit… et puis à la fin, il y a l’image de l’enfant. En fait, on ne sait pas si tout cela est réel ou dans son imagination.
Vous avez tourné dans la cité Bassens et à Félix Pyat. Comment avez-vous été accueilli ?
Jean-Bernard Marlin : Bien. Je connaissais la cité Bassens depuis l’adolescence, et je connaissais des gens là-bas qui m’ont aidé à tourner. Par contre, je ne connaissais pas Félix Pyat.
Vous travaillez actuellement sur un troisième long-métrage, pouvez-vous nous en dire plus ?
Jean-Bernard Marlin : Je suis en train d’écrire un projet qui se déroule dans un environnement rural en dehors de Marseille. Je souhaite changer de registre et de genre et j’envisage de travailler avec des comédiens professionnels.
Qu’aimeriez-vous que le public, en particulier les jeunes, retienne de votre film, d’autant qu’il résonne fortement avec l’actualité ?
Jean-Bernard Marlin : Je souhaite transmettre un message de paix à travers le film. De plus, j’aimerais que le public le vive comme une expérience sensorielle immersive, le plongeant dans un état second. En fait, j’espère qu’il sera perçu comme un véritable film-trip (conclut-il en riant).