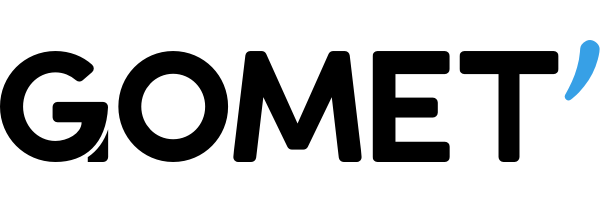Jacques Garnier est économiste, l’un des rares économistes qui a consacré une grande partie de son activité à décrypter le territoire régional avec précision et empathie: Fos-sur-Mer , La Ciotat, les clusters, la zone d’activité de Milles, les pôles technologiques . Il est l’auteur d’un ouvrage de référence sur notre région : “Un appareil productif en mutation, les 50 ans qui ont tout changé en Provence-Alpes-Côte d’Azur ” aux éditions Economica Anthropos, 2011. En 1994, il est sorti de sa zone de confort universitaire et devint directeur délégué au développement technologique de l’Europole méditerranéen de l’Arbois de 1994 à 1998. Il a enseigné à l’Université Aix-Marseille II de 1975 à 2008, a été chercheur au Laboratoire d’économie et de sociologie du travail (LEST-CNRS) et directeur de l’Institut régional du travail de 1978 à 1981. Pour les lecteurs de Gomet’, il livre dans cette tribune (*) son regard sur la “parenthèse pause” que nous vivons.
Le confinement dont nous sommes en train de sortir constitue une parenthèse déstabilisante pour chacun. Mais, c’est aussi un épisode extraordinaire de pause au cours de laquelle ont pu être testées quelques voies de bifurcation de notre vie sociale. Certaines de ces voies avaient déjà été esquissées dans le passé récent. Au cours de la parenthèse pause, elles sont apparues au plus grand nombre comme envisageables et praticables. Vraiment ? Prenons quelques exemples.
1. Un intermède de lenteur
Durement marquée par les malheurs familiaux, les souffrances individuelles, l’accentuation des inégalités et l’angoisse générale, la crise sanitaire actuelle est aussi une parenthèse / pause inédite dans le cours frénétique de la vie sociale. Même si certains secteurs indispensables à la vie quotidienne et à la lutte contre l’épidémie poursuivent leur activité, la société est à l’arrêt. La parenthèse ainsi ouverte depuis 7 semaines constitue une rupture brutale avec les principes d’accélération [1] et de continuité 24 / 7 [2] auxquels sont soumises nos sociétés ; ces deux principes emportant les individus dans une course incessante et épuisante.

La période actuelle constitue un ralentissement majeur, jamais vu (ni au cours des guerres, ni au cours des semaines de mai 1968 et de l’hiver 1995), un intermède de lenteur qui s’est installé, une transgression de l’injonction à la vitesse, à la sur-occupation d’un temps libre, que nous avions cru conquérir pour toujours. Elle est un moment de vacuité propice au regard sur le passé dans lequel nous avons cessé de nous enraciner [3], à l’ouverture du regard sur un futur dans lequel nous avions perdu le moyen de loger l’imagination, l’élan et le projet collectif. Cette situation de vide imprévu peut-elle nous émanciper de la sidération dans l’instant, où nous risquons d’être de plus en plus confinés ? Peut-elle être profitable à l’élaboration des changements profonds espérés par beaucoup en dépit de l’absence de perspectives alternatives convaincantes ?
2. Nous vivons dans une « société du risque »
Faisant suite à Tchernobyl, à la Vache folle, au H1N1, aux pics de pollution à répétition, etc., la diffusion rapide et meurtrière du Covid-19 précipite soudainement la prise de conscience générale de ce que nous vivons dans une « société du risque ». Une société dans laquelle le danger invisible n’est plus porté, comme au Moyen-Âge, par les êtres ou les esprits malfaisants, qu’il importe d’éloigner ou d’exorciser par la prière ou le châtiment, mais qui n’en est pas moins invisible [4]. Aujourd’hui, le recours hautement efficace à la science et à la technologie ne parvient pas à éliminer la hantise de la catastrophe [5]. La tentation n’est pas négligeable d’instaurer et d’accepter un « état d’exception » indéfini avec pour conséquence possible la soumission à une organisation politique autoritaire à la fois verticale et opaque, c’est-à-dire le renoncement à la démocratie.

À moins que nous admettions que, même dans le cas de risques d’origine extérieure, « nous sommes tous devenus solidaires par les risques que nous nous imposons les uns aux autres »[6]. Et il est envisageable, dans ce cas, de concevoir ou mettre à profit les innovations techniques et sociales nous permettant de prendre soin (« care ») les uns des autres.
Peut-être la crise actuelle laisse-t-elle entrevoir un cheminement sur cette autre voie, en particulier lorsqu’elle choisit comme figures emblématiques de la résistance au mal les soignants, les caissières, les éboueurs, les enseignants, toutes professions dévolues, précisément, au soin des autres.
3. Les structures hyper-inégalitaires, désormais hyper-archaïques ?
Un réajustement des « grandeurs » [7] sociales est peut-être en voie de s’esquisser, accompagné d’un regard nouveau sur les inégalités sociales. Applaudies tous les soirs à 20 heures, certaines professions remontent soudainement au plus haut d’une échelle de grandeur négligée depuis des décennies : soignants, caissières, éboueurs, aides à domicile, livreurs, ambulanciers, etc. Il s’agit là de professions qui rendent des services à leurs semblables pour leur permettre de vivre et de survivre ; des professions qui ne s’exercent que dans le rapport humain, dans le rapport des corps et, le plus souvent, dans l’affect. On avait bien commencé à percevoir que ces professions non remplaçables par les robots faisaient partie de celles qui seront épargnées par le développement de la « société automatique » [8]. Mais on avait bien compris aussi qu’elles appartenaient encore à la sphère des emplois souvent précaires et mal rémunérés. On ne les plaçait pas aux niveaux élevés des échelles de la grandeur sociale. La crise actuelle apporte la démonstration que ces professions sont vitales, que la société ne peut pas survivre, si elles disparaissent ou si elles flanchent et même, que les puissants ne pourront pas survivre sans elles.
Peut-être sommes-nous en train de reconnaître la nécessité d’opérer un réajustement ou un bouleversement dans la justification des structures hyper-inégalitaires (désormais hyper-archaïques) de notre société ? [9]
4. Vers un rétrécissement des chaînes de production
Face à divers effets boomerang de la mondialisation observés dans le cours de la crise, la nécessité d’un rétrécissement des chaînes de production et des circuits de distribution des marchandises est désormais un objectif admis, du moins pour ce qui concerne certains biens considérés comme vitaux. Certes, la mondialisation ne paraît pas être remise en cause aux niveaux financier et technologique. Les tendances récentes initiant des pratiques d’« économie circulaire » pourraient cependant se trouver légitimées et renforcées au niveau local. Peut-on trouver dans le renforcement de ces tendances une occasion de concilier beaucoup plus qu’aujourd’hui, notamment aux niveaux local et régional, les sphères de l’« économie résidentielle » et de l’« économie productive » ? Peut-on y voir des opportunités pour une meilleure articulation – aujourd’hui altérée – entre les sphères de l’emploi, de l’habitat et du foncier agricole ? Ne peut-on espérer voir ainsi se recoudre des liens sociaux localisés qui avaient été détruits au cours des années de métropolisation et de désindustrialisation conjuguées ?
5. Vers des bifurcations sociopolitiques imprévisibles ?
Comme après chaque grande crise, on est tenté d’avancer les intentions, les hypothèses ou les utopies. Mais nous savons bien aussi que les acteurs mondiaux qui dominent dans les rapports économiques, financiers et culturels sont dotés d’une puissance et d’une force d’inertie très élevées et que les espoirs portés par les opinions publiques peuvent fort bien se trouver mouchetés, surtout dans l’hypothèse d’une pérennisation rampante de la crise.
Est-ce là, une raison de désespérer ?
En réalité, l’Histoire nous apprend que des changements sociétaux majeurs ont pu se produire dans certains pays, sur la moyenne période, alors que peu de prémices permettaient de les envisager. Thomas Piketty [10] dans son dernier ouvrage, multiplie les analyses révélant que certains changements institutionnels et idéologiques, certains mouvements sociaux ou encore le hasard de certains évènements ont permis des bifurcations sociopolitiques imprévisibles quelques décennies auparavant.
La crise d’aujourd’hui ne peut-elle être considérée à la lumière de tels enseignements ? Les pays occidentaux ne sont-ils pas traversés de diverses tendances porteuses d’innovation en matière d’économie sociale et solidaire et dans le registre des « communs » ? L’abandon (provisoire ou définitif ?) des dogmes budgétaires et monétaires dominants ne constitue-t-il pas une esquisse de bifurcation ? De même pour ce qui concerne le réajustement dans l’échelle des grandeurs professionnelles ? Et de même encore s’agissant des ré-articulations envisageables entre l’urbain, le productif et le foncier agricole ?
Mais, bien sûr, la parenthèse pause actuelle ne peut être qu’un moment, sans doute fragile et volatile, pour amorcer ce type de bifurcation…
Jacques Garnier
Venelles, le 2 mai 2020
[1] H. Rosa, 2005
[2] J. Crary, 2014
[3] S. Weil, 1949
[4] U. Beck, 2001
[5] P. Virilio, 2015
[6] U. Beck, 2001
[7] Terminologie utilisée ici par analogie avec le concept de Grandeur développé en 1991 par L. Boltanski et L. Thévenot
[8] D. Cohen, 2015
[9] T. Piketty, 2019
[10] T. Piketty, 2019
(*) Gomet’ Media, attaché à la vitalité du débat local, publie régulièrement des tribunes de contributeurs extérieurs. Ces points de vue n’engagent pas la rédaction.