Ours d’or au Festival de Berlin en février dernier, Dahomey de la cinéaste Mati Diop est sorti dans les salles de la métropole mercredi 11 septembre. Un documentaire captivant et poétique sur le retour vers leur terre d’origine de vingt-six trésors royaux pillés dans les palais de Dahomey (actuel Bénin) par l’armée française lors de la guerre de colonisation en 1892. Un événement éminemment historique que Mati Diop suit, de leur départ du Musée du Quai Branly, jusqu’à leur arrivée au palais présidentiel de Cotonou. Dans ce second long-métrage, la cinéaste franco-sénégalaise, révélée à l’international avec Atlantique, filme avec maestria le cheminement des oeuvres. Elle nous livre un récit singulier où le fantastique s’immisce dans le réel, comme cette voix en langue fon, qui émane de l’oeuvre n°26, minutieusement enfermée dans les réverses du Musée.
Mais Dahomey est aussi l’occasion de porter à la réflexion la réappropriation d’un patrimoine culturel extorqué au peuple béninois. La cinéaste donne alors la parole à des étudiants réunis dans l’amphithéâtre de l’Université d’Abomey-Calavi pour qu’ils s’expriment sur la question. Leurs points de vue percutent et témoigne du long chemin qui reste à parcourir…
De passage à Marseille, nous avons rencontré Mati Diop il y a quelques semaines, à l’occasion de la présentation du film en avant-première au cinéma Les Variétés.
Vous êtes ici en territoire connu, puisque c’est au FIDMarseille que vous avez remporté Le Grand Prix du Jury de la Compétition Internationale pour Mille Soleils en 2013. Puis, vous avez acquis une reconnaissance internationale avec Atlantique, Grand Prix du Jury au Festival de Cannes en 2019, et plus récemment l’Ours d’Or à Berlin avec Dahomey. On connaît votre engagement vis à vis du continent africain, comment avez-vous pris connaissance de la restitution de ces oeuvres d’art au Bénin, et comment vous l’avez su ?
Mati Diop : Je l’ai toujours su, sans jamais prendre l’ampleur et la mesure de la chose. Lorsqu’en 2017, ce terme de restitution refait surface dans le champ politique et médiatique à travers le discours d’Emmanuel Macron à Ouagadougou, disant qu’il faut rendre tout le patrimoine d’ici cinq ans, c’est à ce moment-là que je me rends compte que la question de la restitution est quelque chose que j’ai refoulé. Que j’ai pas eu forcément le courage de regarder dans les yeux, et je pense que c’est typiquement le genre de pathologie que le système colonial visait.
La déculturation des Africains, et finalement après “les indépendances” que je mets bien sûr entre guillemets, il y a un travail qui n’a pas du tout été fait en France : Un système de pensée, un imaginaire avec lequel elle n’a pas finalement rompu, dans lequel on se trouve encore aujourd’hui, extrêmement empêtré. Il aura fallu que je fasse ce film pour démasquer de façon plus consciente, en déconstruisant toute une mise en scène muséale qui consiste à effacer les traces et la violence du contexte colonial dans lequel ces oeuvres ont été arrachées. (…)

Je ne sais pas si vous pouvez imaginer en tant que franco-sénégalaise, lors de sorties scolaires au Musée du Quai Branly par exemple, les traumas que ces expériences ont générés en moi, sans que quelqu’un vous accompagne et vous permette de comprendre le contexte historique. C’est extrêmement troublant, et cela crée des dissonances intérieures. C’est exactement ce que la société française continue de générer : du mensonge et du déni. Et c’est pour cela qu’en 2017, quand ce mot “restitution” refait surface, je réalise tout cela, la façon dont j’ai enterré la chose qui me fait comprendre que mon propre imaginaire reste à décoloniser aussi. Le processus de décolonisation, il est à faire évidemment comme le dit très bien Achille Membé : “Ce que la France a oublié de faire au moment de la décolonisation des indépendances, c’est de s’auto-décoloniser” (…) Je fais partie d’une génération qui théoriquement est censée être née après les indépendances, et on a passé notre temps à nous rendre compte d’un système auquel on était censé avoir mis fin, mais il perdure sous une forme plus ou moins visible (…).
A quel moment avez-vous décidé de vous emparer de ce sujet ?
Mati Diop : En 2017 donc, quand j’entends le terme de restitution, je suis en train de terminer Atlantique et quand j’imagine ces oeuvres retourner en pays natal, la question du retour fait écho à ce que je suis en train d’écrire : c’est-à-dire, ces jeunes hommes morts en mer qui reviennent à Dakar sous forme de fantômes. Je me dis qu’il y a déjà une résonnance avec ce que je suis en train de tisser dans l’Atlantique avec la question du retour, et puis finalement je fais Atlantique. En 2021, l’imminence d’un rapatriement paraît dans la presse. C’est un moment où j’étais en train de m’interroger sur quel prochain long-métrage j’allais faire, et dès l’instant que j’ai su que ces 26 trésors royaux allaient être rapatriés, je n’avais jamais mis les pieds au Bénin auparavant, j’avais l’intuition très forte qu’il fallait absolument que le cinéma se saisisse de ce moment que j’ai instantanément considéré comme étant un moment historique.
La dimension historique est tout à fait questionnable. Qui décide qu’un moment est historique ? Et la question de l’archive s’est posée en premier lieu. Je me suis dit que c’était important que cette restitution ne soit pas simplement captée médiatiquement et fasse partie d’un flux d’informations, mais que le cinéma s’en empare aussi. J’ai donc choisi de filmer ce rapatriement, et puis lorsque s’est posé la question plus concrète de m’engager vraiment dans un long-métrage et que le gouvernement béninois est entré dans cette équation, parce que je ne pouvais faire le film qu’avec son autorisation, c’est là que j’ai choisi d’aller au-delà de l’archive des oeuvres et d’aller interroger la jeunesse sur cette question.
Justement ce qui est intéressant, c’est que ce n’est pas seulement un récit “fantasmagorique” sur la restitution de ces oeuvres au sens large, mais c’est plus spécifiquement de son impact politico-historique auprès de la jeunesse. En quoi c’était important pour vous de leur donner la parole ?
Mati Diop : Ce n’est pas du tout un film seulement sur la restitution. En fait, ce qui m’avait frappé, avant que je fasse ce film, c’est que autant il y avait eu ce rapport extrêmement important écrit et mené par Felwine Sarr et Bénédicte Savoy (respectivement écrivain et historienne de l’art n.d.l.r) “Restituer le patrimoine africain” qui est un ouvrage majeur sur la question, qui m’a beaucoup éclairé, mais ce qui me semblait assourdissant, c’est que la jeunesse africaine sur cette question, on ne l’a pas entendu. Pour moi : restitution et jeunesse africaine, c’est une association que j’ai faite immédiatement, de façon très évidente. Très vite dans ma tête c’était le point de vue des oeuvres, le point de vue de la jeunesse.

Leurs interventions sont percutantes, comment avez-vous choisi les étudiants ?
Mati Diop : Je les ai rencontrés à l’Université d’Abomey-Calavi, après un premier casting réalisé par mon assistant Gildas Adonnou, un jeune cinéaste béninois. Je lui ai expliqué le type de profil que je cherchais, c’est-à-dire des jeunes qui avaient un point de vue singulier sur cette question, qu’ils pouvaient assumer et défendre publiquement, parce qu’il y a quand même un héritage assez fort de la censure au Bénin. Il fallait des jeunes qui n’aient pas froid aux yeux. J’ai donc casté quelques profils issus de disciplines différentes en cinéma, histoire, économie, sociologie.
C’est d’abord de restituer le débat à la jeunesse béninoise.
L’idée étant de réunir des gens qui ne pensaient pas la même chose, pour vraiment complexifier le plus possible cette question. J’ai aussi choisi des personnes qui étaient vraiment très démunies face cette question, et d’autres plus armées. L’idée étant de réunir ces personnes, et de leur soumettre une série de questions pour qu’ils s’interrogent, de sorte que le débat ne soit surtout pas quelque chose de figer mais au contraire, comme une sorte de magma de chants et de fréquences qui se produit et qui ouvre des champs de réflexion. Car, c’était important pour moi que ce champ de reflexion vienne du continent, du Bénin, de cet amphithéâtre. Parce que, finalement, mon geste à revendiquer dans le film, c’est d’abord de restituer le débat à la jeunesse béninoise.
D’autant que la jeunesse africaine est au coeur de vos sujets comme dans votre précédent long métrage, Atlantique…
Mati Diop : Je n’ai pas la prétention de traiter la jeunesse africaine, elle est bien trop vaste, elle est très différente d’un pays africain à l’autre. En tout cas, j’ai choisi de consacrer un film à Dakar, à une certaine jeunesse qui émigre, puisque ce sont pour des raisons assez intimes mais aussi au vu de la situation politique que j’ai rencontrée que j’ai décidé d’engager mon cinéma à Dakar en 2008.
A l’origine je partais à Dakar pour entreprendre un film qui est devenu Mille Soleils mais qui était censé être un dialogue entre Touki Bouki (un film de Ddjibril Diop Mambéty, l’oncle de la réalisatrice n.d.l.r ) et le présent, et la jeunesse qui émigre. Puis, avant que Mille Soleils ne se développe narrativement, j’ai fait un court-métrage qui s’appelle Atlantique qui est sorti en 2009 et qui en effet créé un espace de paroles entre un jeune sénégalais qui vient juste d’être rapatrié d’Europe et qui raconte à ses meilleurs amis, sa traversée en mer.
J’ai choisi de mettre mon cinéma au service de ces dépossédés
Pour moi, c’était très important déjà à l’époque de rendre une parole à ce jeune homme dont une jeunesse africaine me semblait dépossédée. Quand je parle d’une jeunesse africaine, je parle d’une jeunesse africaine qui émigre et qui à l’époque était représentée par des médias de masse occidentaux d’une manière qui me choquait énormément. C’est à dire déshumanisée et réduit au statut de victimes et de parasites. Et ça, c’est quelque chose qui m’a profondément insurgée et j’ai choisi de mettre mon cinéma au service de ces dépossédés.
C’est-à-dire, qu’en tant que franco-sénégalaise, en tant que Française, j’avais la possibilité de voyager de réunir du matériel de tournage, et j’avais accès à ces jeunes là. D’autant que j’étais tout le temps à Dakar avec mon cousin qui avait l’âge du protagoniste. C’est quelque chose qui s’est fait de façon très organique. Je ne suis pas la cinéaste de la jeunesse africaine et je ne m’octroierai jamais cette place. Je ne pars jamais d’un film en me disant que je vais filmer la jeunesse africaine. C’est la façon dont ma vie intime résonne avec les faits aussi (…). J’ai eu besoin de me décentrer et de résister à l’idée que le centre était la France, l’Europe, l’Occident et que je devais me définir à partir de ce centre de gravité. J’ai résisté vraiment à cette idée héritée des Lumières ou des ténèbres, je ne sais pas (elle rit). Évidemment que l’héritage politique de mon oncle y est pour beaucoup. Puisque les films qu’il nous laisse, dont je ne suis pas l’unique héritière, il suffit de s’en réclamer.

Pour en revenir au film, ce qui est captivant aussi, c’est que vous faites parler les oeuvres, comme si vous faisiez revivre les âmes anciennes de la culture africaine, à l’instar de la sculpture du Roi Ghézo. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Mati Diop : Ce qui a toujours été très clair pour moi, c’est qu’en réalité ces oeuvres sont des véhicules et c’est aussi le rôle de l’art. Au-delà de l’âme de ces oeuvres, cette voix va bien au-délà des vingt-six trésors et du roi Ghézo qui l’incarne. C’est l’âme de toutes ces femmes et de tous ces hommes déportés pendant la traite, c’est l’âme des dépossédés de l’âme coloniale, c’est aussi l’âme des migrants d’aujourd’hui. Certains spectateurs m’ont dit que cela leur avait fait penser aux voyages qu’ils avaient fait en accompagnant la dépouille de leur père, de leur mère en Afrique.
Dahomey, un voyage que l’on fera un jour
Quand on est un enfant d’immigré en France, on sait que c’est un voyage que l’on fera un jour, retourner au pays avec le corps de son père, de sa mère français d’origine. Donc c’est nous, c’est toute cette communauté d’âmes, passées, présentes et futures en réalité. En revanche, quand cette âme déambule dans les rues de Cotonou, on est principalement avec l’âme de ce que véhiculent les oeuvres et le passé auxquelles elles se rattachent. L’idée était de faire se rencontrer cette histoire passée qui rencontre cette histoire présente. Quelles frictions cela provoquent de travailler cette voix des trésors en écho avec le choeur des étudiants et de travailler cette matière de façon presque opératique. Cette voix, c’est aussi l’âme des femmes, des hommes déportés pendant la traite, du golfe du Bénin, entre autres, vers ce qui est devenu notamment Haïti. C’est la raison pour laquelle j’ai confié le texte à un écrivain ha¨tien, Makenzy Orcel.
Justement, comment avez-vous découvert cet auteur ?
Mati Diop : Je n’avais pas lu ses romans quand je l’ai rencontré. Il m’a été présenté par Henri Roy, un ami photographe franco-haïtien, qui connaît très bien mon travail et qui m’a parlé de Makenzy, de ce qui semblait traverser son travail. J’ai senti que c’était lui et je l’ai rencontré aussitôt. Il a vu les rushes et on s’est tout de suite très bien aligné.
Les Béninois ont-ils vu le film ?
Mati Diop : Oui, le film a été montré en première mondiale au Bénin et au Sénégal. J’y tenais. Les projections ont eu lieu dans les cinémas et dans des projections spéciales que nous avons organisées sur le campus de l’Université où nous avons tourné, à l’Université de Dakar également.
Quelles ont été les réactions ?
Mati Diop : Le film a été très bien accueilli et les quelques retours que j’ai reçus ont été globalement très forts. Mais je pense que j’aurai besoin d’y retourner pour avoir des échanges plus approfondis avec les spectateurs. Mais c’est vrai que j’ai le sentiment qu’il faudrait consacrer un temps un peu plus long. Mais c’est moi qui est une petite frustration parce que je trouvais que c’était extrêmement difficile de faire venir les gens dans les salles. J’aurais souhaiter qu’il y ait des projections organisées intra-muros qui permettent des débats un peu plus amples. Je pense que la liberté de parole, c’est quelque chose que je cherche, c’est vraiment l’espace que je créé dans mes films, que je continue d’essayer de dessiner, de rendre possible, un espace de parole libre et précise.
Liens utiles :
L’actualité du cinéma dans notre rubrique
Dahomey sur AlloCiné
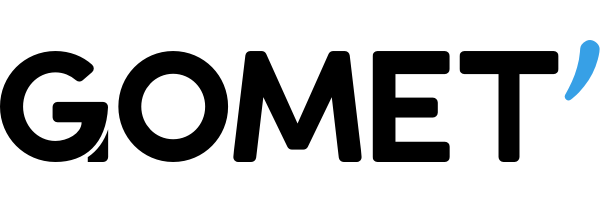


![[Agenda] Aix-Marseille Provence : que faire ce week-end des 25, 26 et 27 avril ?](https://gomet.net/wp-content/uploads/2025/04/rubrique-agenda-we-1-1140x570-1-120x86.png)









