Dans le cadre des Rencontres de la finance verte organisées par Gomet’, Pierre Batteau, économiste, professeur émérite à l’IAE d’Aix-en-Provence, spécialiste des questions financières qu’il a enseignées un temps aux Etats-Unis, livre ici son analyse de l’évolution des pratiques dans le monde de la finance sous la pression de la transition écologique. Rien ne change mais tout peux changer…
La finance traite des flux monétaires dans l’économie. Elle est la contrepartie de la circulation des flux physiques de biens et services. Sa fonction est de convoyer (de recycler en quelque sorte !) les ressources monétaires tirées de la richesse produite hier vers la production de nouvelles richesses demain. Or, le futur est par essence incertain et dans les opérations de « recyclage » de la finance, le maître mot des chercheurs et l’obsession des praticiens est « risque ».
Depuis la première révolution industrielle à la fin du 18e siècle, la sphère financière fait l’objet de recherches conduites par des mathématiciens, des physiciens, des sociologues, des psychologues, des économistes… leur thème essentiel est le risque. Une vingtaine de Prix Nobel d’économie ont été attribués depuis 1983 pour des travaux directement centrés sur le traitement du risque par les individus, les entreprises et les marchés du risque. Pour la finance verte, le risque demeure donc le fil conducteur de toute recherche en la matière.
Par définition, le risque pour un financier est toujours attaché à un décideur particulier : il existe en raison d’un défaut de connaissance de ses déterminants par ce décideur et au moment de la décision car cette connaissance aurait pu permettre d’ajuster la décision et de la rendre meilleure. Le risque c’est l’information manquante du décideur ! On doit le distinguer de l’aléa qui concerne un événement susceptible de représenter des risques variés pour différents décideurs. Du point de vue de la finance, un aléa climatique tel qu’un cyclone n’est générateur de risques que pour les décideurs amenés à formuler des décisions face à lui.
Pour illustration, l’entrepreneur qui initie un projet de transition énergétique de plusieurs millions d’euros, (donc un investissement de long terme) le juge socialement utile, durable, voire « rentable », sur la base de sa propre connaissance de la technologie, des métiers et des débouchés impliqués par le projet. Cette connaissance est fondée sur son expérience (son savoir tacite) et a été enrichie par des études préalables. Mais au moment de décider, il demeure encore une multitude de paramètres inconnus et c’est cette connaissance manquante qui fait le risque. En effet, il est possible qu’à l’autre bout de la planète un laboratoire soit en train de mettre au point une technologie alternative qui pourrait invalider le projet dans un délai plus court que l’horizon visé. L’entrepreneur et ceux qu’il embarque avec lui, seraient bien sûr désireux d’accéder à cette connaissance. Il y a ainsi dispersés dans le monde des gens qui en savent plus que nous sur chacun des milliers de paramètres qui affectent nos décisions, mais l’acquisition de toute l’information nécessaire pour être assuré de prendre la bonne décision est impossible. Donc tout projet comporte un risque résiduel et il faut trouver celui ou celle qui sera mesure de le couvrir pour le compte de l’entrepreneur car ce dernier est rarement capable de le faire tout seul. L’ingéniosité et la richesse personnelle ne sont en effet que faiblement corrélées. Mais la finance est là pour ça et c’est son rôle principal.
Qui assumera le risque ?
Les institutions financières sont donc des lieux d’échange de connaissances, sans qu’il soit besoin de décrire et de spécifier celles-ci. Le mécanisme de la propagation de la connaissance dans les flux financiers a constitué depuis plus de cent ans, et constitue toujours, un puzzle pour tous ceux qui opèrent dans ce domaine, chercheurs et praticiens. A l’instar des haruspices qui lisaient l’avenir dans les méandres des entrailles des poulets, comment lire l’avenir de la Planète dans l’inspection des méandres des flux financiers et des institutions qui les pilotent ?
Qu’il soit un particulier, une association, une start-up, ou une entreprise industrielle ou commerciale, l’entrepreneur doit alors trouver dans son environnement un ou des agents qui acceptent de prendre en charge tout ou partie du risque résiduel, à des conditions à définir, et c’est la fonction de toutes les institutions financières : être un intermédiaire pour le transfert des risques et donc faciliter l’échange de connaissances.
Pour assurer certains risques, on peut se tourner vers les institutions spécialisées dans l’Assurance, mais leur champ est limité aux aléas sur lesquels on peut acquérir une information statistique fiable et lorsque la composante « morale » du risque demeure contrôlable. Ceci est généralement impossible pour les projets inédits et originaux à horizon long et en période de révolution industrielle, c’est-à-dire pratiquement pour tous les projets « verts ». Donc l’assurance classique est ici laissée de côté ici, bien qu’elle puisse être qualifiée, tout autant de finance verte lorsqu’elle imagine des contrats pour couvrir les formes nouvelles de risques environnementaux extrêmes.
Pour d’autres risques, l’acquisition de la connaissance complète est impossible, mais le projet génère des « effets externes » vertueux, c’est à dire des effets qui améliorent la richesse de tous sans que personne ne puisse s’en emparer de façon privée. L’État peut alors accepter de prendre le risque à sa charge. On rentre alors dans le maquis de la fiscalité, des crédits d’impôts, et des subventions publiques.
La troisième façon de se débarrasser de risques non assurables et qui ne peuvent entrer dans la mansuétude de l’État, consiste à identifier les partenaires auxquels l’entrepreneur peut transférer ces risques via des contrats bilatéraux. Ces contrats se distinguent selon les conditions qui fixent la compensation offerte au contributeur pour cette prise de risque, allant du partage complet des pertes ou bénéfices (par l’émission d’actions par exemple) jusqu’à l’indexation de la compensation sur une information complètement indépendante des performances du projet (par des obligations à intérêt fixe). Cette compensation peut être monétaire ou non monétaire, et ce dernier cas se produit en fait très souvent.
Ces contrats peuvent être taillés « sur mesure » pour l’entité concernée (emprunt bancaires, parts, actions, swaps, etc.) ou conclus entre investisseurs verts (fusions, spin-offs, partenariats…). Dans ces cas, les marchés financiers ne jouent qu’un rôle indirect dans le transfert du risque. Le banquier qui prête à une petite entreprise dont les titres ne sont pas côtés utilise lui-même le marché financier pour se refinancer et couvrir ou répartir son propre risque. L’ « equity fund » qui entre dans une start-up compte aussi sur le marché financier pour lui fournir la compensation due à la sortie, sous forme de plus-value et il peut même exploiter d’autres instruments sur les marchés de dérivés, pour limiter son propre risque résiduel.
Cependant en bout de chaine, l’absorption du risque résiduel des projets verts, (comme celle de n’importe quel autre projet), s’effectue au travers des échanges sur les marchés financiers d’actions, d’obligations et de dérivés, d’instruments standardisés.
L’asymétrie d’informations
Un marché financier, comme Janus, a donc deux faces. L’une révèle une partie de l’information détenue par des centaines de milliers de « sachants » anonymes, détenteurs d’une petite partie de la connaissance pertinente au projet et l’autre face, établit un mécanisme subtil d’assurance. Alors que dans l’assurance classique l’assureur et l’assuré sont clairement distingués dans leur rôle respectif, sur un marché financier au contraire, tous les intervenants sont simultanément assureurs par l’information implicite qu’ils apportent à d’autres agents par leur intervention sur le marché, et assurés par le transfert de risque qu’ils reçoivent du marché auquel ils ont recours.
La finance verte n’a donc rien de fondamentalement différent de toute autre forme de finance et les cadres et les modèles théoriques explorés depuis des décennies demeurent adaptés pour en rendre compte. Elle doit simplement traiter les nouveaux risques liés aux transitions écologiques et énergétiques et ses spécificités résident dans les modifications de comportement de certains acteurs : quelle acceptation chez les épargnants primaires (c’est à dire essentiellement les ménages), de la prise en charge volontaire de ces risques. Par ailleurs, les compensations non-monétaires qu’attend un apporteur de capitaux à des projets risqués par le biais de dons ou de legs à des fondations ou de financement direct d’événements doivent être mieux explorées pour comprendre les phénomènes dits de Green Washing.
L’importance et la portée des comportements « altruistes » ou « socialement responsables » chez les épargnants
Au programme de la recherche sur la finance verte, on va donc retrouver les modèles et les principes classiques des financiers : ceux que l’on enseigne à New York comme à Aix-Marseille ou à Hong-Kong, dans tous les cours de finance des écoles de management. Ils portent sur l’efficience informationnelle des marchés et leurs accidents possibles, sur l’examen du couple « rentabilité –risque », sur la diversification comme outil majeur de partage des risques et de gestion des portefeuilles, sur la corrélation que le marché établit entre la valeur d’un instrument et les facteurs de risque non diversifiables qu’il est censé couvrir (ce que les financiers appellent les « betas » du modèle). Il faut perfectionner la compréhension des effets de l’asymétrie de connaissance entre les parties d’un contrat (Jean Tirole, prix Nobel français, en a écrit un manuel de base utilisé par les étudiants de master et de doctorat de toute la planète). Il faut aussi explorer la nature et le rôle de tous les intermédiaires de la chaine de transferts des risques. Il faut encore mieux connaitre le comportement des ménages qui sont les plus gros offreurs, par leur épargne, de potentiels capitaux verts sous formes directe ou indirecte (livrets, assurance vie, ETF, fonds de pensions, comptes spécialisées etc.). Il y a là des dizaines de sujets d’études et de thèses en vue ! Enfin la question lancinante depuis des décennies de la « structure financière optimale » (le ratio dette/capital) de l’entreprise doit être réexaminée lorsque les projets verts dominent pour fournir de nouveaux principes utiles aux décideurs.
Le financier qui considère le volume de savoir accumulé sur la finance depuis un demi-siècle sur des institutions qui manipulent chaque jour des flux financiers gigantesques à l’échelle globale, est évidemment enclin à penser que les menaces climatiques et environnementale ne devraient pas fondamentalement changer les principes de la finance, à peu près les mêmes dans chaque pays, sauf évidemment renversement complet de paradigme économique. Mais ce renversement ne s’est même pas produit en Chine malgré une doctrine politique toujours officiellement révolutionnaire.
Une partie originale mais qui demeure encore marginale, est l’importance et la portée des comportements « altruistes » ou « socialement responsables » chez les épargnants. On la devine par la montée en puissance aux USA et en Europe d’un engouement pour les fonds qui certes diversifient mais de façon sélective dans des projets jugés vertueux pour la planète. Cette sélectivité n’est pas nouvelle et elle s’exerce depuis des décennies aux États-Unis sur des projets à fort enjeu éthique pour certaines catégories d’épargnants qui refusent de financer indirectement certaines activités qu’ils jugent contraire à leur morale. Mais autant que je peux en juger de ma connaissance, cette sélectivité n’invalide pas les modèles dont nous disposons pour étudier ces phénomènes. De manière générale, les comportements qui entendent marquer une plus grande responsabilité sociale se manifestent chez les ménages beaucoup plus par l’engagement associatif ou des formes de militantisme pour la protection de notre environnement, incluant des dons et des contributions volontaires, que par l’abandon de la compensation attendue pour mettre à disposition sa propre épargne pour les investissements verts. Pour les entreprises aussi cet engagement se manifeste plutôt par le « sponsoring » ou par l’exercice d’une responsabilité sociale au travers de multiples actions, pouvant certes cacher parfois des ambitions ou des effets pervers moins amicaux pour la Planète.
Une augmentation du coût du capital pour les entreprises vertes
Pour illustrer l’un des aspects les plus déconcertants pour l’étudiant des marchés financiers animé du souci de promouvoir les investissements verts, il suffit de remarquer que les risques associés à de tels investissements sont nécessairement plus élevés que ceux d’activités relevant du « business as usual ». Il s’agit en effet des risques de technologies encore mal maitrisées, des risques de concurrence destructrice entre technologies alternatives (ex : solaire contre éolien, biomasse contre nucléaire) et surtout des risques de réglementations changeantes au gré des majorités politiques en Europe et en Amérique (que l’on pense au cas du glyphosate !). La théorie financière, bien documentée à ce sujet fait toujours l’hypothèse que les épargnants qui acceptent un risque plus élevé en attentent une compensation plus forte. Ceci se traduit mécaniquement par une hausse du coût du financement des projets verts et donc à leur freinage. Cette augmentation du coût du capital pour les entreprises concernées pourrait cependant être atténuée, voire inversée, par le comportement des « fonds socialement responsables ». Il y a là tout un champ d’investigation pour la recherche en finance, déjà engagé depuis une dizaine d’années. Par ailleurs, alors qu’on cherche à impliquer des investisseurs plus « responsables » et moins gourmands, l’augmentation attendue des compensations et du risque attire plutôt les investisseurs individuels les plus riches qui peuvent se permettre d’être perdants parfois, pour être gagnants sur longue période, comme le montre les données empiriques. De même que la révolution industrielle de la fin du XIX siècle a amplifié les inégalités de richesse, celle qui est en cours et qui est induite pour une bonne partie par nos efforts de sauvegarde de la planète, pourrait in fine, se traduire par un fort accroissement des inégalités sociales si les régulateurs n’apportent pas un soin particulier à la fiscalité des revenus tirés des révolutions vertes.
L’initiative de Gomet’ sur la finance verte, devrait nous permettre de mieux partager nos connaissances et nos informations relatives à ce secteur de l’activité que l’on peut qualifier sans jeu de mots de « capital » pour notre futur collectif.
Pierre Batteau
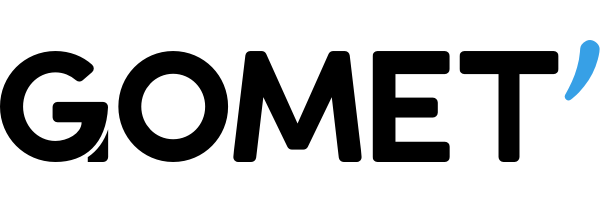

![[Analyse] Finance verte : en quoi diffère-t-elle de la finance blanche, rouge, grise, ou noire ?](https://gomet.net/wp-content/uploads/2023/11/pierre_batteau-750x375.jpg)








![[Agenda] Aix-Marseille Provence : que faire ce week-end des 25, 26 et 27 avril ?](https://gomet.net/wp-content/uploads/2025/04/rubrique-agenda-we-1-1140x570-1-120x86.png)


