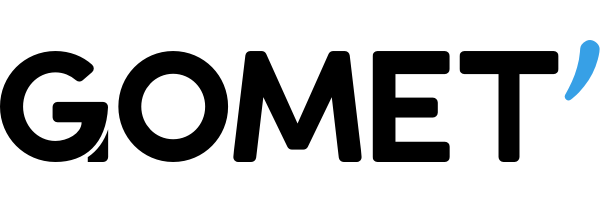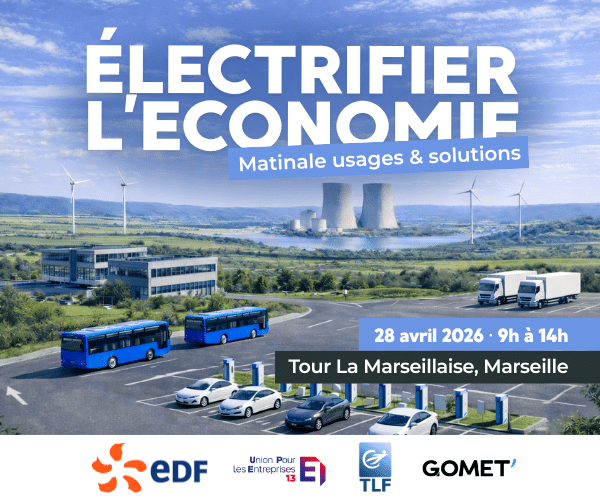A Marignane on peut s’envoler, mais hors de question de voler. Jusqu’à un bout de pain, même s’il est promis à la moisissure. Ainsi va la vie professionnelle, en ce début d’année 2025, dans un aéroport réputé international. Quatre salariés ont été licenciés par la société SSP qui gère différentes boutiques de ce carrefour du monde, pour avoir distribué, notamment à des sans abri, de la nourriture destinée à être détruite car ayant atteint sa date de péremption. La société, montrée du doigt et exposée au feu nourri des bonnes âmes choquées par sa méthode expéditive, se défend bien sûr. « Il est de notre entière responsabilité, dit-elle dans un communiqué, de veiller à ce qu’en aucun cas, les dons alimentaires ne soient distribués de manière informelle, non encadrée et opaque. C’est dans cette exigence de responsabilité que nous avons souhaité mettre fin au plus vite à ces pratiques. » La pédagogie donc, avec un principe de précaution qui se tient, mais une répression disproportionnée qu’aura à examiner la justice.
Du coup, sans l’avoir prévu, ces quatre malheureux salariés au cœur aussi grand que la béance des ventres auxquels ils comptaient porter secours, ont braqué un cours instant un rai de lumière crue sur les SDF. Ils crient famine dans et autour de Marseille et leur nombre ne cesse de croitre alors que leurs oripeaux ont du mal à couvrir les pauvres carcasses qui servent d’ultimes abris à ces âmes en détresse.
Rien de nouveau sous le soleil provençal, qui siècle après siècle, fait de Marseille un cul de sac pour toute la misère du monde, sans qu’une politique digne de ce nom arrive à y porter un vrai remède. L’immense Albert Cohen qui partagea des années heureuses avec un copain du Grand Lycée (l’actuel Lycée Thiers), Marcel Pagnol, a décrit entre les deux grandes guerres, en quelques lignes, ce qui est encore une réalité aujourd’hui : « Cet enchevêtrement de ruelles, de maisons accolées, de porches rafistolés, de fenêtres énigmatiques, dans ce refuge ouvert depuis les premiers âges de la ville à tous ceux qui portaient en eux douleur, peur, faim, ou goût de l’ombre. ». Cohen venu de Corfou avec ses parents, a heureusement connu lui ce que Jean-Claude Izzo nommait « le bonheur fugace des exilés ».
Car cette ville, baptisée en 1934 « métropole des mendigots » par le journal Le petit Marseillais, a depuis la nuit des temps voulu faire un sort à ce peuple des rues qui participe, selon les bien-pensants des bastides et des artères choyées, à sa mauvaise réputation. Un édit royal appelait en 1641 à « enserrer » ces gens de peu à la Vieille Charité et on recommandait de « faire défense de leur donner retraite ni aumône ». Il s’est même trouvé, en 1995, trois glorieux policiers municipaux pour tenter de déporter un mendiant à Vitrolles, après l’avoir roué de coups à l’Estaque. Jean-Claude Gaudin y alla lui d’une peu chrétienne mesure en signant, en 2011, un décret anti-mendicité. Paix à son âme.
La décrue est-elle amorcée trente ans après ? Rien n’est moins sûr puisqu’une récente nuit de la solidarité a permis de comptabiliser plus de 500 malheureux naufragés dans la rue, parmi lesquels des femmes et des enfants. Les centaines de bénévoles marseillais, qui tentent avec de pauvres moyens d’endiguer cette marée montante, constatent, une maraude après l’autre, qu’apparaissent de nouveaux visages, de nouvelles détresses, de nouvelles questions. Tenter de vider cet océan avec une cuillère est admirable, mais n’arrive pas à stopper l’inexorable agonie de ces sans-nom qu’on finit par reconnaître à force de les voir sur leurs matelas souillés ou trainant d’infâmes couvertures.
C’est la « petite dame » à la voix de fillette lorsqu’elle vous remerciait d’avoir lâché une pièce, noyée dans un manteau trop long et trop large qui tendait encore cet hiver la main, sortie pour quelques pas fragiles de son refuge poubelle. Le printemps revenu, elle n’est plus apparue. Un jour de pluie on l’a aperçue, une dernière fois, recroquevillée sur un pas de porte avenue du Prado. Elle réclamait un café chaud pour chasser les frissons qui envahissaient son semblant de carcasse. Disparue donc la fluette Causette, corps et sans bien.
C’est ce garçon, un long échassier aux épaules tombantes, qui joue encore au guide devant un bureau de poste où les clients pressés et stressés ne le voient, ni ne l’entendent. On dit qu’il fit partie jadis à Aix d’une famille aussi aisée que respectable, mais personne ne sait pourquoi la vieillesse l’a envahi avant qu’il ne l’atteigne.
C’est ce blond encore au catogan soigné qui sourit et remercie parce quelques euros ont rejoint sa timbale. Il cache dans son dos une cannette de bière qui mettra un peu plus de brume à sa mémoire. On l’a vu pourtant porter secours à un de ceux avec qui il s’use d’alcool des heures durant. L’homme s’était endormi sur la chaussée et, avec un passant, le « blond » l’a mis à l’abri avec ce commentaire : « les pompiers vont venir le chercher, ils le connaissent bien à l’hôpital ! » Lui échappe encore à cette noyade.
Parmi ses ombres, qui ont renoncé depuis longtemps à tenter de faire société, il y a mille chemins arrêtés, mille destins empêchés, mille raisons de ne plus espérer. Les juger serait les accabler un peu plus sans commencer à ébaucher le moindre soupçon de solution. Il faudrait inventer un nouveau monde pour ces gens car dans leur vie il fait faim, il fait froid, il fait vide.
Deux présidents de la République avaient promis d’y porter remède. Nicolas Sarkozy voulait en 2006 que « plus personne ne soit obligée de dormir sur le trottoir ! » Emmanuel Macron dira de même ou presque, une décennie plus tard. Les promesses d’une campagne ne garantissent jamais d’échapper à des défaites… en rase campagne.
En 2025, ils sont au moins 200 000 à ne pas disposer d’un domicile fixe dans l’Hexagone. A Marseille, va et vient oblige, les statistiques ne sont pas fiables à 100%, mais on est sans doute proche des 20 000, sans compter bien sûr ceux qui sont réfugiés dans un habitat plus qu’indigne, des squats ou même, comme on l’a déjà vu il y a quelques années, des semblants de grottes sous Notre Dame ou la Corniche Kennedy.
Les associations caritatives, des services municipaux, les refuges et haltes de nuit – Secours populaire, Emmaüs, secours catholique, Samu social… – sont mobilisés 24h sur 24 pour apporter au moins attention à cette détresse généralisée qui tente de survivre de la Canebière aux grandes avenues, du centre-ville aux quartiers les plus pauvres.
Comme il faut saluer le travail accompli dans le cadre du projet Assab qui permet année après année de recenser cette population marginale et d’apporter, au-delà d’une attention nécessaire, les soins de premières urgences que réclame leur santé en ruine. La ville de Marseille, l’hôpital européen, l’Agence Régionale de Santé, la direction départementale du travail et de la solidarité sont de cette aventure-là. Elle est forcément harassante, coûteuse, désespérante aussi devant l’ampleur de la tâche.
On rêve du coup, comme on sait en organiser tant d’autres, à des « Assises de la rue », pour tenter de dessiner des solutions pérennes. Tout ce qui compte de forces vives, d’institutions, de pouvoirs politiques pourraient s’y associer. Une des associations marseillaises qui se bat aujourd’hui dans la quasi indifférence générale a choisi un nom prometteur, La Nouvelle Aube. Si ce jour se levait, nul doute qu’on entendrait la voix fluette de la petite dame de l’avenue du Prado dire, depuis l’infini qui l’a engloutie : « merci ».