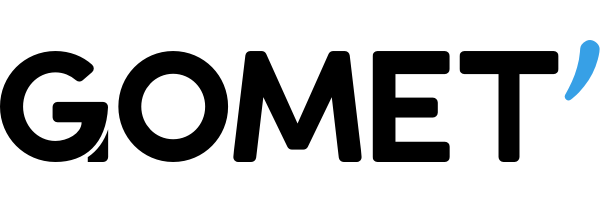Cela aurait pu être leur curriculum vitae. Ce fut plutôt, dans ce numéro de La Provence qui annonçait « le procès de la rue d’Aubagne », leur épitaphe. Huit morts parfaitement innocentes mais coupables de n’avoir pas les moyens de vivre ailleurs que dans des taudis que des propriétaires osaient appeler appartements, studios ou meublés.
A lire les lignes qui leur étaient consacrées ce jour-là, on pouvait dessiner ce que les sachants désignent par « profils sociologiques ». Des pauvres, pour faire court, venus souvent d’ailleurs pour nourrir la peur et la rancœur des Zemmour et autres Bardella et faire prospérer l’idée qu’une submersion migratoire métastasait la bonne ville de Marseille.
Et comme d’autres sont condamnés aux abysses en Méditerranée, ces huit-là ont été engloutis sous la pierre fragile d’immeubles tombeaux et rayés des listes des vivants, à cause du goût du lucre d’une poignée de malfaisants. Benoît Payan, le maire de Marseille, a décidé qu’on ne les oublierait pas. Dans ce qu’on nomme désormais « la dent creuse », en lieu et place des deux immeubles gommés du cadastre, on va bâtir une structure associative et réserver un espace consacré aux gens de ce quartier Noailles enfin pris en compte par les autorités.

Sous le soleil, rien de nouveau
Pour faire bonne mesure l’édile de gauche assure qu’il implorera « le pardon » pour la ville puisque la municipalité que le Printemps marseillais a battue n’a jamais cru bon de le faire. Pour autant sur le tableau noir de la mémoire collective il reste beaucoup encore à effacer. Car, à feuilleter l’histoire de la ville, la catastrophe de la rue d’Aubagne rappelle une vérité têtue : depuis des siècles se côtoient à Marseille la misère la plus profonde et l’opulence la plus abjecte. Mais ce sont toujours les mêmes qui passent à la caisse, les laisser pour compte, les misérables, les invisibles.
Dans « Paroles » le poète Prévert écrivait : « Il est terrible le petit bruit de l’œuf dur cassé sur un comptoir d’étain. Il est terrible ce bruit. Quand il remue dans la mémoire de l’homme qui a faim ». Pour emprunter à frère Jacques, il est encore plus terrible le silence de ces huit victimes de la rue d’Aubagne, qui ont été contraintes d’accepter l’inacceptable pour aller se loger dans ce qui aurait dû être un toit, un abri, un refuge.
La justice va passer. Les uns argueront de leurs bons droits, d’autres tenteront de se dédouaner, tous diront leur regret, peu parleront de remords. Et la politique dans tout ça ? Quelques-uns iront alourdir la pierre sous laquelle repose « en paix » ceux qui étaient aux affaires et n’ont rien vu venir, rien voulu prévoir et, in fine, rien assumer. Les autres se démarqueront de ce passé passif. Ils murmureront, en se dissimulant, un hypocrite « plus jamais ça ». Ils savent pourtant que demain, dans cette cité qui se hausse du col en annonçant un futur « euroméditerranéen », surgiront encore des catastrophes moyenâgeuses avec des bailleurs véreux, des propriétaires peu sourcilleux, des élus pas précautionneux. Car sous ce soleil rien de nouveau. De lourds nuages porteurs de détresse, ont toujours plané sur la ville. Avec une constante : ce sont toujours les populations les moins bien loties qui sont frappées par le malheur.

Aujourd’hui on estime ainsi à plus de 40 000 le nombre de personnes vivant dans des masures… réputées inhabitables. Ils furent autant à être touchés, puis à succomber en 1720. Mais c’est la peste qui avait sévi alors, suite à la négligence criminelle d’un capitaine, Jean-Baptiste Chataud. Il avait refusé d’appliquer au navire qu’il commandait, Le Grand Saint Antoine, la réglementation qui visait les bateaux infectés. Ce fut la vieille ville (l’actuel Panier) qui paya d’emblée le plus lourd tribut à cette terrible épidémie, comme en témoignent encore les nombreux charniers découverts régulièrement dans les fondations de ces immeubles miséreux.
Le sociologue Jean Viard affirmait après la catastrophe de la rue d’Aubagne que « le logement populaire n’était pas dans les préoccupations principales » de Jean-Claude Gaudin. L’histoire bégaye donc car si la peste, en son temps, a d’abord frappé les quartiers les plus insalubres, c’est qu’ils n’étaient pas dans les priorités de ceux qui s’enrichissaient grâce à l’activité portuaire et vivaient déjà dans des bastides protégées, loin de la plèbe et de ses miasmes.

Rue de la République, de la création à la revente
Plusieurs décennies après la peste, la bourgeoisie marseillaise avait « au temps béni des colonies » prospéré un peu plus encore. Ce sont encore ces quartiers misérables et cette population opprimée qui ont payé le prix de la rénovation. Il ne s’agissait pas alors de restaurer des immeubles en friches ou en péril, mais de les raser pour percer la butte des Carmes et des Moulins et y tracer une rue de La République qui se voulait impériale. On décida, en 1858 de détruire près d’un millier de maisons et 61 rues, totalement ou partiellement. On déplaça 16 000 Marseillais dont les historiens nous disent peu ce qu’il advint d’eux.
Plus de cent ans plus tard, la municipalité de Jean-Claude Gaudin incitait des fonds de pension à s’emparer de ces beaux immeubles haussmanniens après un terrible constat. Si les pauvres avaient été chassés de ces hectares, les nantis ne les habitèrent jamais. Ils les laissèrent, pour ceux qui les avaient acquis, se paupériser lentement, sans se préoccuper outre mesure des habitants qu’ils y logeaient.
Plus radicale encore la solution finale préconisée par le chef des SS, Heinrich Himmler. Il considérait que ces hectares, où était née la ville il y a 2600 ans, étaient « le plus grand centre de criminalité du monde, dirigé par des milliers de personnes de race étrangère ». « Ce chancre de l’Europe » fut donc rasé à la dynamite, en janvier 1943. Les nazis épaulés par la police française ajoutèrent au déplacement brutal de milliers de Marseillais, la déportation massive de juifs, d’immigrés, d’homosexuels et de tous ceux qui avaient tenté de faire résistance. Pour ajouter à cette horreur le Maréchal Pétain, ricanant sur les ondes, crut bon de commenter ainsi ce crime de guerre : « Ce n’est pas dommage. Je suis même assez d’accord qu’on ait mis par terre ce quartier. »
La paix retrouvée, la ville a-t-elle pour autant plus d’égards pour ces milliers de familles qui vivent dans ce que l’euphémisme désigne par un « habitat indigne ». Il faudrait sans doute plus d’un plan Marshall, pour réparer des ans l’outrage fait à nos bâtisses qui firent naguère la fierté des Marseillais de souche. On s’enorgueillissait volontiers alors de ces façades percées de trois fenêtres et que l’arrivée du métro et du tramway comme au Camas, à Longchamp ou encore rue de Rome ou boulevard Baille devaient valoriser un peu plus encore. Ce fut le cas parfois, grâce à ce que l’on appelle « la gentrification », les bobos prenant d’assaut la ville et son art de vivre au soleil en reléguant les plus pauvres vers des quartiers en déshérence ou pire, hors les murs.
Comment recoudre la ville ?
Le phénomène était pourtant prévisible, si l’on avait observé ce qui s’est passé à New York, Londres ou Paris. Et puis, et c’est une constante dans cette ville pauvre malgré le fard insolent de quelques réussites, nombreux sont les propriétaires incapables d’assurer la pérennisation et donc l’entretien de leurs biens. Un survol en drone suffit pour distinguer dans certains quartiers des verrues immobilières, des dangers immédiats, de nouveaux drames à venir. Les copropriétés vivent l’enfer pour maintenir ici et là en bon état l’habitat ancien. Comme on a pu le voir au quartier Mazarin à Aix, où nombre d’héritiers autrefois prestigieux n’ont pas les moyens d’entretenir leur patrimoine, pléthores sont les Marseillais qui peinent à assumer un bien immobilier. Ils s’entêtent malgré tout, si ce n’est à le rentabiliser, au moins à le faire survivre.
Reste la loi. Elle dira ce qu’elle peut dire à l’issue du procès en cours. On pinaillera sur la temporalité d’un « arrêté de péril », on ergotera sur la responsabilité des uns ou des autres, on assurera que la page est tournée. Mais le livre qui dira comment « recoudre la ville » pour emprunter une expression chère à M. Payan, reste à écrire.