Alain Trannoy, économiste marseillais dont nous suivons les travaux vient de sortir avec l’historienne Arundhati Virmani « Économistes et historiens, un dialogue de sourds ? » chez Odile Jacob.
Dans Le Monde Pascal Riché en raconte la genèse : « Il y a quelques années, l’École des hautes études en sciences sociales a eu la bonne idée de renouer le dialogue entre ces deux planètes dans le cadre d’un séminaire sur le campus de Marseille. Chaque mois, un économiste prend la parole sur l’un de ses sujets de recherche, et un historien l’interroge ensuite. Le mois suivant, c’est un historien qui relate une période, et un économiste lui apporte la réplique. Début juin 2021, dans le sillage de ce séminaire, 18 économistes et historiens (ainsi qu’un philosophe) se sont retrouvés à Tourtour (Var) pour un conclave de trois jours abrité par la Fondation des Treilles. Le livre reprend ces belles discussions. » Alain Trannoy répond aux questions de Gomet’ sur cette démarche.

Avec l’historienne Arundhati Virmani vous publiez un ouvrage chez Odile Jacob sur la relation histoire et économie. Aux sources de la discipline économique, les grands fondateurs ne sont – ils pas aussi historien… ou éthiciens ?
Alain Trannoy : Oui, à l’origine les fondateurs de l’économie politique encastrent l’économie dans une vision philosophique et politique. C’est le cas de l’école du mercantilisme avec une réflexion sur le souverain et donc l’État, les physiocrates (François Quesnay) avec une première approche du libéralisme, Adam Smith qui est un penseur profond avec non seulement « La Richesse des Nations » mais aussi « La Théorie des Sentiments Moraux ». Le rapport à l’histoire économique est évident chez les quantitativistes (théorie quantitative de la monnaie) qui s’interrogent sur l’impact de la découverte des métaux précieux sur le niveau des prix mais aussi chez Malthus et évidemment Karl Marx.
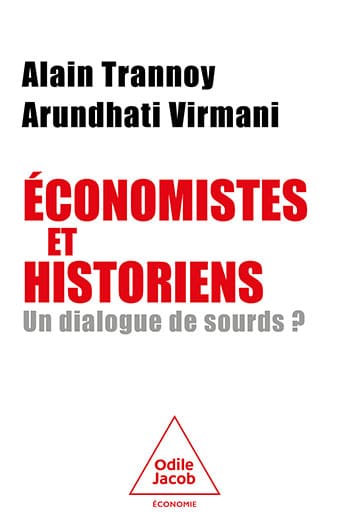
En quoi les méthodes (ou les modes) ont-elles éloigné recherches historiques et recherches économiques ?
A.T. : On trouve encore chez Kuznets et Schumpeter un rapport avec l’histoire économique dans les années quarante et 50. Entre 1950 et 1990, la discipline économique concentre son effort sur des aspects théoriques, en particulier sur le concept d’équilibre. Cet équilibre quand il est stationnaire où toutes les valeurs se reproduisent d’une année sur l’autre ou sa généralisation, un état stable, toutes les variables économiques croissent au même taux, représentent une négation de l’histoire qui est faite de contingence, où il n’y a pas de loi. Cette période 1950-1990 représente sans doute celle de la tentation de la part des économistes d’une approche s’inspirant de la physique. C’est largement Paul Samuelson qui a donné le ton.

Quel rapprochement semble possible pour, comme vous le formulez, « penser la fragile fabrique des savoirs en sciences humaines » ?
A.T. : D’abord, les économistes s’intéressent aux données historiques pour tester ou remettre en question des idées reçues, pour tester sur le temps long la solidité de toute ou partie du corpus de la théorie économique. Mais ils le font à leur manière avec une haute dose de statistiques et d’économétrie qui ne peut pas être appréhendée par les historiens avec leur formation actuelle. Les économistes ont besoin des historiens pour ne pas faire de contre-sens sur l’emploi des données historiques, pour comprendre le contexte. Nous appelons de nos vœux des travaux qui conjuguent les points forts de chaque discipline pour faire avancer les sciences sociales. Est-ce que les historiens peuvent être naturellement tentés par cette collaboration, l’avenir nous le dira.
Ceux qui comme Jacques Marseille ont traité d’histoire et d’économie sont rares ou peu connus. Qui, où, comment pourrait se faire un rapprochement, qui semble évidemment nécessaire, entre les chercheurs du temps long et ceux du mécano économique présent ?
A.T. : Vous parlez de Jacques Marseille dont les travaux sur l’empire colonial français ont trouvé un large public. Les travaux de Denis Cogneau « Un empire bon marché » mériteraient d’être mieux connus. Ils remettent en cause justement certains des résultats de Jacques Marseille. Thomas Piketty dans une large mesure a réalisé un travail nouveau sur l’évolution des inégalités sur le temps long mais certains lui reprochent de ne pas mobiliser toutes les ressources de la théorie économique pour les comprendre. La synthèse de Charles Serfaty sur « une histoire économique de la France de la Gaule à nos jours » est d’une grande qualité et il n’a que trente ans.
Lien utile :
Alain Trannoy, Arundhati Virmani Économistes et historiens, un dialogue de sourds ? Editions Odile Jacob 304 pages 25,90 €


![[Livre] L’économie, c’est tout une histoire, et réciproquement…](https://gomet.net/wp-content/uploads/2025/02/capture-decran-2025-03-02-a-12.32.50-750x375.png)







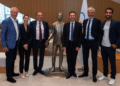
![[Agenda] Aix-Marseille Provence : que faire ce week-end du 13 au 15 février ?](https://gomet.net/wp-content/uploads/2026/02/rubrique-agenda-we-3-120x86.png)



