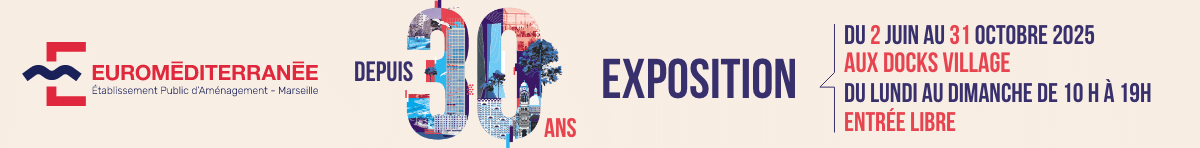Jean Bonnier vient de sortir, aux éditions Les impliqués, un livre témoignage : « A la rencontre des forêts méditerranéennes » (1). Ancien du Secrétariat général aux affaires régionales, le Sgar, ce fonctionnaire bouillonnant a fait entendre sa voix rocailleuse dans tous les cénacles : de la préparation des plans état-région aux colloques internationaux sur la forêt, des débats du prémonitoire Club de réflexion sur l’aire métropolitaine marseillaise aux couloirs des ministères. Ses colères maîtrisées, sa connaissance des dossiers, son humour, ses idées disruptives et sa capacité à aller à contre-courant en ont fait une voix qui compte.

Son livre se veut un témoignage sur les forêts méditerranéennes. Elles structurent, écrit-il, « les territoires au sein desquels se joue et se développe la vie de nos contemporains, sans qu’ils se rendent toujours compte de leur importance, de leurs multiples valeurs et de leur complexité, de leur dynamique, des services qu’elles rendent et des nécessités de leur gestion. » Pour Gomet’ il précise d’abord : « quand je parle de forêts méditerranéennes, je parle de forêts particulières liées aux climats et aux sociétés de ces régions situées tout autour de la Méditerranée : 25 pays et 100 millions d’hectares. L’approche de la très large majorité de nos contemporains régionaux est, malheureusement, déterminée par des discours nationaux, voire mondiaux qui, associant l’Amazonie et la Trévaresse, peuvent passer à côté des questions réelles qui se posent chez nous. C’est un des objets majeurs de mon livre. » Interview que nous diffusons à l’occasion de la journée internationale des forêts ce dimanche 21 mars.
Vous êtes un « baroudeur de la forêt », président d’honneur de Forêt méditerranéenne, ancien du Sgar, et vous publiez un livre qui rassemble tout ce que vous avez appris, comme agronome comme aménageur sur nos forêts et sur leur vie. Comment voyez-vous évoluer cette forêt méditerranéenne avec le réchauffement climatique ?

Jean Bonnier : Avec quelques certitudes, car on voit déjà les effets du changement comme la perte de feuilles des pins d’Alep, au couvert bien plus léger que naguère, et aux chênes verts ou aux chênes-lièges qui durant les deux années passées ont perdu leurs feuilles au milieu de l’été comme on a pu le voir dans les Maures ou dans le Luberon ; on voit aussi souffrir les châtaigniers des Cévennes… Les chercheurs le confirment et le quantifient dans leurs études à Roquefort-la-Bédoule, à Puéchabon (Hérault) ou à Saint-Michel de l’Observatoire (Alpes de Hautes Provence.). On pense qu’il est à peu près certain que la végétation méditerranéenne va peu à peu gagner plus de la moitié du territoire national avec ce que cela implique de changements des systèmes végétaux, jusqu’en Bourgogne par exemple, dans la productivité des forêts et… dans les dangers d’incendies.
Quel diagnostic portez-vous sur l’état de la forêt sur notre territoire métropolitain ?
J-B. : Les forêts de la métropole Phosalyenne (Aix Marseille) se portent plutôt bien en ce sens qu’elles sont déjà assez aguerries au changement du climat ; elles sont pour l’essentiel en milieux climatiques subhumide, humide et de montagne, qui vont évoluer doucement vers plus d’aridité. Cela signifie que peu à peu le décor va évoluer pour ressembler un peu plus à l’Espagne centrale (la Mancha, la Catalogne et l’Aragon).

Il faut renoncer à l’étalement urbain
Jean Bonnier
Par ailleurs, les incendies qui sont relativement maîtrisés par les progrès de la lutte, mais sont menacés par ceux, encore très insuffisants, de la prévention et des précautions des habitants très majoritairement de culture citadine. Le premier danger est le mitage (le terme a été employé pour la première fois dans les Bouches-du-Rhône, au début des années 1970 !) qui artificialise et imperméabilise les sols, perturbe les prix fonciers et met les habitants et leurs forêts voisines en danger : il faut renoncer à l’étalement urbain.
Aux yeux du public l’incendie semble l’ennemi. Qu’en est-il ? La cause en est-elle, comme on l’écrit au moment des grands feux, une délinquance spécifique ?
J. B. : Les études ont montré que les premières causes d’incendie sont les imprudences dans l’exécution des travaux agricoles et forestiers et des activités des résidents en milieu boisé dans leur vie quotidienne (travaux et loisirs). Le reste ce sont les imprudences générales, comme les mégots et autres pratiques. Bien sûr qu’il y a aussi des crimes mais ce sont les négligences qui sont les plus criminelles notamment par l’absence d’entretien des terrains autour des maisons.
Peut-on imaginer avec les particularités de notre territoire une économie qui incite à cultiver la forêt ?
Il est nécessaire que nos contemporains apprennent comment « fonctionne » un écosystème forestier
Jean Bonier
J. B. : Oui, mais pour cela il faudrait que le public et ses élus acceptent certaines pratiques culturales : en forêt, cultiver implique de récolter, ce qui veut dire couper du bois (bouscatier est un beau mot provençal). Cela, la plupart des sylviculteurs savent le faire proprement et utilement. Une sylviculture active pourra, en outre, permettre des opérations d’adaptation des peuplements au changement climatique et au soin de la biodiversité. Mais il est nécessaire que nos contemporains apprennent comment « fonctionne » un écosystème forestier, qui ne cesse d’évoluer, qui n’est pas un monument immobile et immuable et qui connaît une étonnante résilience.