Pour le journaliste économique, la figure de Jean-Claude Gaudin évoque immanquablement ses prises de parole dans les entreprises ou lors de conférences de presse sur des projets économiques. Lorsqu’il fut élu président du Conseil régional en 1986, il parcourut ainsi avec beaucoup de conscience professionnelle, les six départements, dont il connaissait tous les acteurs, tous les conflits et tous les leviers qui permettaient de glaner des soutiens. La prise de parole du président de Région était un rituel. Tout d’abord Jean-Claude Gaudin ne manquait pas de saluer un à un ceux qui étaient les amis d’un jour. Et il avait un signe amical pour celui qu’il avait éventuellement oublié au fond de la salle.

Puis il entreprenait de lire son discours. Alain Caraplis, le directeur du protocole lui avait glissé une chemise soigneusement préparée, avec un propos en gros caractères et avec un interligne conséquent. En bon acteur il ne trébuchait pas sur les mots fussent-ils les plus complexes, il avait lu son texte et préparé son passage en scène. Puis venait le moment inévitable : « Je viens de vous lire ce que mes collaborateurs ont préparé, mais je tenais à vous dire que…» suivait alors, ou une anecdote 1 000 fois entendue, mais que l’on réécoutait avec plaisir comme on regarde un vieux film de Louis de Funès, ou un commentaire politique du jour, maudissant comme il se doit « le pouvoir socialiste ».
L’économie ne passionnait pas Jean-Claude Gaudin. Prof d’histoire et de géo, il avait privilégié l’histoire et avait dû sécher les cours de géographie économique. Il n’empêche que lors de ses mandats, les institutions qu’il présida firent de l’économie.
Route 128 versus Route des hautes technologies
À la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, lorsqu’il arrive en 1986, il a préparé avec un jeune élu issu de l’immobilier, Jean-Louis Geiger, le projet de Route des hautes technologies. Il était parti analyser aux États-Unis ce qu’était la route 128 et avait eu l’audace de tracer une route des technologies sur un territoire que l’on croyait dévolu au tourisme ou aux industries en déclin. La RHT s’appuyait sur la notoriété de Sophia-Antipolis et de Pierre Laffitte qui jouait le jeu ; passait par Toulon où Patrick Valverde devint avec Toulon Var Technologie l’homme du retournement économique de la cité de la Marine ; arrivait à Marseille ensuite, prenait appui sur le pôle de Château-Gombert en difficile émergence ; se dirigeait dans le Vaucluse ce qui permettait de mettre en avant un pôle agronomique que personne n’avait vu naître. La route sinueuse filait ensuite vers Cadarache incluant donc les 6 000 personnes du site, puis grimpait vers Gap où un petit technopôle était en constitution à l’entrée de la ville. Jean-Claude Gaudin, en fin politique, avait tout de suite acheté l’idée et laissé Jean-Louis Geiger, qui s’appuyait sur son directeur, Philippe Zanin, piloter ce projet avec pour président le chercheur reconnu François Kourilsky, de l’Inserm.

Un terreau fertile
C’était la première fois qu’une politique publique mettait en avant le potentiel scientifique et technologique de toute la région et ce fut la première fois qu’avec l’agence Sudreporters que je dirigeais et la journaliste Marie-Noëlle Delfosse nous fîmes le premier inventaire des laboratoires de recherche de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Nous étions à la préhistoire. Mais ce terreau n’en doutons pas fut fertile : lorsque l’État lança un appel à projets pour les pôles de compétitivité, la surprise fut grande, au niveau de l’Etat, du nombre de candidatures structurées. Ces projets firent naître des pôles toujours vivaces qui organisent les filières innovantes de la région.
À la Ville de Marseille, la gestion économique se fit plus évanescente. Le candidat Gaudin voulait associer le patronat à son nouveau mandat, mais seul finalement Jean-Louis Tourret eut en charge la représentation patronale et on lui confia le poste des finances. Le maire de Marseille a souvent revendiqué la baisse réelle du taux de chômage sous ces années de gouvernance, elle était passée de 20 à 11 %. Il est difficile d’y voir le résultat d’une politique et d’une stratégie économique.
Les ZFU
À l’actif du défunt maire, reconnaissons le rôle des zones franches qui permirent de relocaliser des activités économiques et industrielles sur le nord de Marseille avec deux Zones franches urbaines (ZFU) :
- ZFU Nord Littoral (dispositif de 1997) : quartiers Saint Henry, Saint André, Saint Antoine et ZAC Saumaty Séon
- ZFU 14ᵉ et 15ᵉ Sud (dispositif de 2004) : quartiers La Delorme, Saint Joseph, Les Arnavaux, Sainte Marthe, Saint Barthélemy, Bon Secours, Le Canet, la Cabucelle et Saint Louis.
L’équipe du maire a longtemps revendiqué les bénéfices d’Euroméditerranée qui permirent de rattraper le retard phocéen en matière de locaux tertiaires et de localisation de sièges d’entreprises. Mais c’est oublier que, à l’origine Jean-Claude Gaudin et Claude Bertrand, son interface, combattirent avec acharnement le projet et sa mission de préfiguration portée alors par Pierre Fiastre, Jean-Pierre Weil et Daniel Carrière. Comme souvent et, avec talent, Jean-Claude Gaudin endossa les bénéfices du projet après avoir obtenu que la direction soit Gaudin-compatible. Mais entre-temps Euromed avait perdu de sa substance : l’ouverture vers la Méditerranée et la mixité sociale.
En fait, ce sont les projets de Robert-Paul Vigouroux, qui ont transformé Marseille et ce sont les décisions prises au début des années quatre-vingt-dix qui ont permis de renverser l’image du territoire et de devenir attractif pour les entreprises.
Une capacité à endosser les projets des autres

Souvenir : à peine assis dans le fauteuil du maire, la municipalité organisait une visite de ce qui n’était qu’un chantier : l’amphithéâtre du Pharo. Pendant toute la campagne, l’équipe Gaudin avait dénoncé ce projet « pharaonique » du maire qui endettait la ville et détruisait le paysage. La visite de presse pilotée par Claude Bertrand était là pour démontrer le gigantisme du projet et son inutilité. Quelques mois plus tard, chaque fois qu’une délégation ou un colloque se déroulait au Pharo, Jean-Claude Gaudin se faisait un plaisir de valoriser ce site extraordinaire, vantant les mérites de l’amphithéâtre capable de recevoir dignement des manifestations d’ampleur. Maire acteur, maire caméléon, il sut profiter de l’arrivée du TGV puis de Marseille 2013, année européenne de la culture.
Là aussi l’équipe municipale n’avait pas cette échéance dans son calendrier et c’est Jacques Pfister, président de la Chambre de commerce appuyé par son communicant Laurent Carenzo, qui firent le job, portèrent le projet, inventèrent un programme détonnant et finalement remportèrent cette année européenne, l’ancien maire négociant avec le gouvernement pour l’implantation du Mucem au Fort St-Jean comme il aima le rappeler dans de multiples circonstances. L’équipe mise en place su en faire un événement national et européen, ce que toutes les capitales européennes n’ont pas réussi et ce fut un succès qui a marqué le retour de Marseille dans le jeu des grands. Jean-Claude Gaudin endossa l’habit et finalement cette échéance vint à l’actif de son bilan.

Il était proche des professionnels de l’immobilier, cultiva ses relations avec de grands patrons comme Jacques Saadé ou Marc Pietri, mais il restait étranger à l’entrepreneuriat, à ses acteurs de terrain, aux enjeux du développement, même s’il participa au cours de son dernier mandat à quelques voyages à l’étranger pour vendre la destination Marseille comme à Londres en 2016 et Miami en 2017 ou. En économie, Jean-Claude Gaudin, se comporta en pur homo politicus avec toujours une capacité à se retourner et à faire de chaque progrès économique un bénéfice pour sa conquête ou son maintien au pouvoir.
En savoir plus :
> Un « hommage républicain » rendu à Jean-Claude Gaudin
> L’ancien maire de Marseille Jean-Claude Gaudin est décédé
> Décès de Jean-Claude Gaudin : « C’est une partie de moi qui s’en va » (Martine Vassal)
> Réactions à la mort de Jean-Claude Gaudin : « un grand maire » selon Renaud Muselier
> Notre rubrique politique






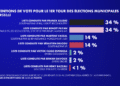

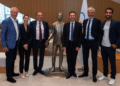

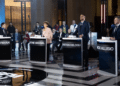
![[Agenda] Aix-Marseille Provence : que faire ce week-end du 27 février au 1er mars ?](https://gomet.net/wp-content/uploads/2026/02/rubrique-agenda-we-4-120x86.png)


